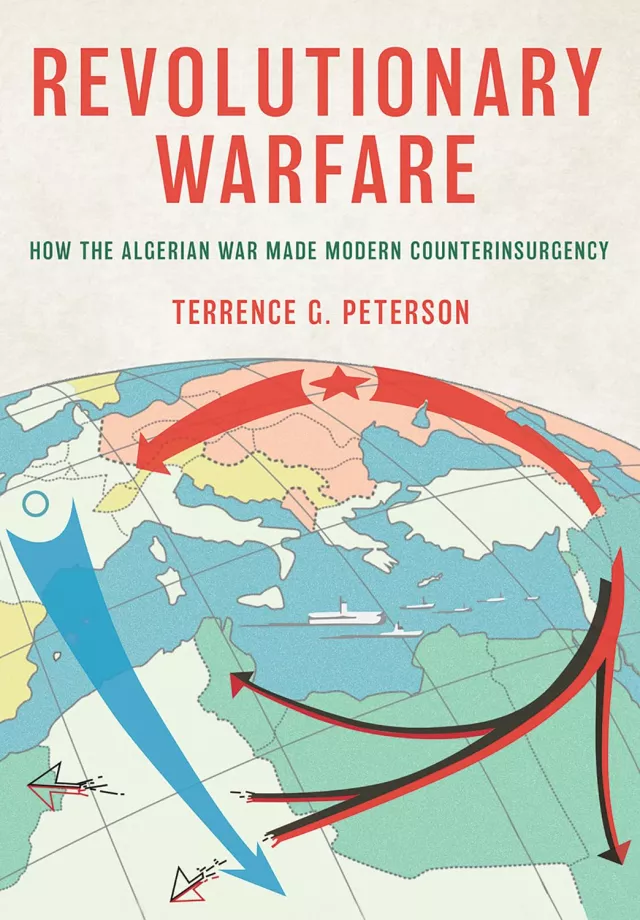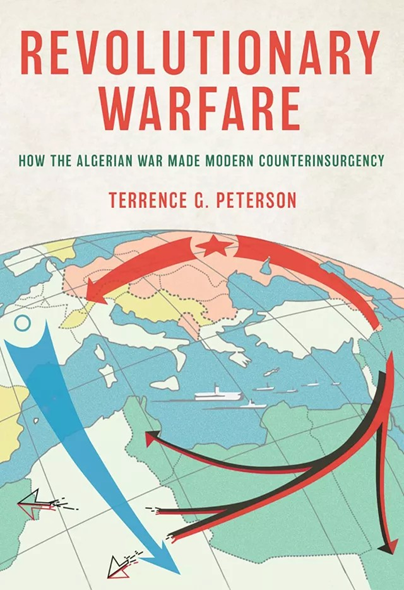L’évocation « d’Oradours » durant la conquête de l’Algérie par Jean-Michel Aphatie a suscité des réactions indignées qui témoignent d’un déni persistant des connaissances historiques.
Les déclarations du journaliste Jean-Michel Apathie sur les « nombreux Oradours » commis par l’armée française lors de la conquête de l’Algérie, ont suscité une avalanche de protestations indignées. Leur thème dominant fut : des soldats français ne pouvaient pas avoir fait cela.
Ces protestations ignorent l’histoire concrète de nombreux épisodes des guerres coloniales, de la conquête de l’Algérie à celle de l’Indochine, en passant par les raids sur des villages africains ou les massacres de kanak, une histoire documentée depuis des lustres par une quantité imposante de témoignages et de traces écrites. Elles partent du principe qu’il y aurait une nature intrinsèque de l’être humain français sous l’uniforme qui rendrait impossible que de tels faits pourtant parfaitement établis aient pu être commis.
Aucune de ces protestations ne s’est appuyée sur la documentation existante, notamment sur l’abondante correspondance des généraux de la conquête de l’Algérie, dont Bugeaud, qui ont décrit par le menu de tels actes.
La parution récente de l’ouvrage d’Alain Ruscio, qui porte précisément sur la période de cette « première guerre d’Algérie », permet cependant d’affirmer qu’il y eut maints et maints assauts de villages qui se sont achevés dans le sang, parfois, par l’extermination de populations entières.
Nous présentons ici quelques pages issues de cet ouvrage, décrivant des destructions totales de lieux et des élimination physiques de masse. Comparaison n’est pas raison : mais comment ne pas penser à Oradour ?
Le duc de Rovigo et le massacre de la tribu des El Ouffia, avril 1832
Les dix-huit mois de la présence française virent défiler trois commandants en chefs, remerciés pour des raisons variées. Le quatrième fut un homme à poigne : Anne Jean-Marie René Savary, duc de Rovigo nommé le 6 décembre 1831. Sa nomination, en remplacement de Berthezène, jugé conciliateur par les colonistes, eut une signification évidente : seule la manière forte pouvait mettre les indigènes à la raison. Car Rovigo avait une longue carrière, connue de tous, aux côtés de Bonaparte, souvent faite de brutalités et d’exactions à l’extérieur (Égypte 1798-1799, Espagne 1808) et à l’intérieur (il avait été ministre de la Police de 1810 à 1814, se distinguant par son « mépris des garanties légales et de la vie humaine »). À son âge, 57 ans à ce moment, il n’allait pas changer ses « habitudes impériales » (Amédée Desjobert).
La population algérienne devait vite subir ces « habitudes ». C’est sous son mandat qu’éclata la plus grave affaire des cimetières détruits et des ossements dispersés (voir chapitre 20).
Les morts furent donc profanés… et les vivants furent assassinés.
La terrible affaire du massacre de la tribu d’El Ouffia, installée à El Harrach, débuta comme un banal fait divers. Des émissaires d’un caïd* du Constantinois, Ferhat ben Saïd, surnommé « le grand serpent du désert », allié des Français, furent interceptés et dépouillés par des maraudeurs, non loin de Maison-Carrée, à dix kilomètres d’Alger, sur un territoire où vivait la tribu d’El Ouffia, celle-ci n’ayant en rien participé au vol. Malgré cela, une expédition punitive fut immédiatement décidée. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1832, une colonne, entre 600 et 800 hommes, selon les sources, fondit sur le village au petit jour. Les habitants, écrivit Pellissier de Reynaud, furent égorgés, « sans que ces malheureux cherchassent même à se défendre. Tout ce qui vivait fut voué à la mort ; tout ce qui pouvait être pris fut enlevé ; on ne fit aucune distinction d’âge ni de sexe ». Seuls furent épargnés « quelques femmes et quelques enfants », par « l’humanité d’un petit nombre d’officiers. » Furent également épargnés – provisoirement – deux chefs de la tribu, Rahbia ben sidi Grahnem, appelé par les textes postérieurs El Rabbia, et Bourachba, en vue de faire un exemple marquant les esprits (voir infra).
La plupart des récits estiment qu’il y eut entre 80 et 100 morts. Si ces chiffres sont fondés, cela signifie qu’il y eut entre six et huit assaillants pour un habitant tué.
Le raid avait été rapide. Dès l’après-midi, la troupe revint. Certains soldats français arboraient fièrement des têtes piquées sur leurs lances. Afin de doubler cette répression, une opération visant à terrifier la population algéroise, le reste du butin – « des bracelets de femmes qui entouraient encore des poignets coupés et des boucles d’oreilles pendant à des lambeaux de chair » fut exposé au marché de Bab-Azoun. Enfin, pour célébrer cette « grande victoire », le commissaire de police de la ville d’Alger ordonna à la population indigène d’illuminer la ville « en signe de réjouissance. »
Or, entre temps, les vrais coupables, appartenant à la tribu toute différente des Krechnas, avaient été découverts et avaient même rendu le produit du larcin. Se produisit alors un épisode qui ajouta le sordide au criminel. Que faire des deux chefs de la tribu ramenés à Alger, évidemment innocents, dès lors que la responsabilité de leur tribu était de façon publique écartée ? Le baron Louis-André Pichon, intendant civil, plaida pour la relaxe. Ce à quoi Rovigo répondit d’une formule qui en dit long sur l’état d’esprit de bien des officiers de l’époque : « Je n’ai pas d’autre justice que la justice militaire (…), il vaudrait mieux n’en avoir pas du tout que de traiter ces peuples-ci avec les ménagements qui suffisent pour gouverner ceux de notre pays. » Selon cette logique implacable, quatre condamnations à mort pour « crime d’embauchage » et « trahison envers la France » furent prononcées, dont deux par contumace (14 avril). Rovigo bafoua même la propre loi des Français, qui ne prévoyait d’exécutions capitales que lorsque des Français avaient été victimes (arrêté Clauzel, 15 octobre 1830, article 1er). L’appel fut rejeté (17 avril). Deux sentences furent donc appliquées. Les condamnés furent exécutés en public le 19 avril, à Bab Azoum. Ce fut, affirma l’historien Dieuzaide, un « assassinat juridique ». Entre le début du drame et ces exécutions, il s’était passé deux semaines.
Après l’injustice, les coups bas. Le commandant en chef, outré qu’un civil ait osé remettre en cause son autorité, obtint rapidement le rappel du baron Pichon (d’autant qu’un accrochage sur une question politique d’importance, l’accélération ou non de la colonisation des terres, les avait déjà opposés. Voir chapitre 13). Le 10 mai 1832, un mois après les exécutions, Pichon fut remplacé par Pierre Genty de Bussy (1795-1867). Le 12 mai, une ordonnance royale accorda à Rovigo la prééminence totale, désormais, sur les autorités civiles.
Rovigo, se débarrassant d’un opposant à Alger, envoya en fait un ennemi tenace à Paris. Pichon se révéla redoutable, contactant divers milieux, donnant des détails sur le forfait. Devant le scandale, une commission d’enquête fut dépêchée et fournit en juillet 1833 un rapport accablant : l’attitude du commandant en chef fut jugée « en contradiction non seulement avec la justice, mais avec la raison ». Le rapport final dénonçait le drame d’El Ouffia :
« Nous avons envoyé au supplice, sur un simple soupçon et sans procès, des gens dont la culpabilité est restée plus que douteuse depuis. […] Nous avons égorgé, sur un soupçon, des populations entières qui se sont ensuite trouvées innocentes. »
Le duc de Rovigo ne fut pour cela être inquiété. Et pour cause : le 4 mars précédent, il avait quitté l’Algérie, suite à un mal de gorge persistant qui se révéla être un cancer du larynx. Arrivé à Paris le 30 mars, il fut jugé par les médecins inopérable. Il mourut le 2 juin 1833, un mois avant la publication de ce rapport.
Un fait, pourtant, ne fut pas relevé par la presse. Trois semaines après le massacre, une colonne de la Légion étrangère fut attaquée et anéantie dans la même région. Cette colonne avait participé à ce massacre, et tout laisse à penser qu’elle fut ciblée pour cette raison. Christian Pitois (1811-1877), historien de la colonisation (qui signait P. Christian) ne put que constater, désolé : « Le duc de Rovigo ne savait que nous faire haïr et mépriser. »
Mais la mémoire coloniale n’eut pas cette sévérité : en 1846, un village de colonisation, à moins de 30 km d’El Ouffia, reçut le nom de Rovigo. Le nom du duc est honoré sur l’un des piliers de l’Arc-de-Triomphe.
L’enfumade de Dahra, juin 1845
Enfumer : contraindre des populations à se réfugier dans des endroits isolés, en l’occurrence des grottes, puis les brûler et / ou les asphyxier. Cette forme de répression fut, quantitativement, une goutte d’eau dans l’océan des victimes de la période étudiée. Mais son caractère particulièrement macabre, puis, surtout, l’éclatement du scandale en métropole, ont grandement contribué à en faire un symbole de l’inhumanité de cette guerre.
Celle des grottes du Dahra est passée à la postérité par les révélations qui furent faites quasi immédiatement et portées à la connaissance du public. La répression n’avait pas mis fin à l’agitation dans l’ouest algérien. Il fallait en finir.
Le général Aimable Pélissier, commandant de la subdivision de Mostaganem, était à la poursuite des tribus insurgées. Il avait correspondu avec Bugeaud, alors en poste à Orléansville, après avoir lui-même guerroyé. C’est de ce poste que Bugeaud adressa à son subordonné une phrase terrifiante : « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbeahs ; fumez-les à outrance, comme des renards » (11 juin). En possession de ce blanc-seing, Pélissier passa à l’acte. Sa colonne possédait une supériorité écrasante : 2 254 soldats bien armés, disciplinés, encadrés, face à une à deux centaines d’hommes dont le seul avantage était la connaissance du terrain (ils n’appartenaient pas aux troupes régulières d’Abd el-Kader, ils étaient plutôt des francs-tireurs) armés de fusils de chasse ou d’armes récupérées auprès des Français.
Le drame se déroula sur trois jours, les 18, 19 et 20 juin 1845. La colonne avait été harcelée par des tireurs isolés. Elle fit le vide devant elle en brûlant habitations, récoltes, champs et vergers de la région. Face à cette avancée, les combattants et les populations (leurs familles) se replièrent vers les grottes du Frechich, qu’ils connaissaient bien. Pélissier chargea un interprète de leur faire savoir qu’ils risquaient la mort par l’incendie ou l’asphyxie. Cinquante-six mules chargées de produits combustibles accompagnaient la troupe. Le reste, pour alimenter le feu, fut fourni par les fascines (fagots faits avec les broussailles environnantes). Les négociations échouèrent : Pélissier demandait une reddition pure et simple. Quelques coups de feu furent échangés. Malice, couverture (dans la crainte d’une éventuelle divulgation de l’acte) ou strict sens de la discipline, Pélissier ponctuait son récit d’une référence aux ordres de Bugeaud :
« Je n’eus plus qu’à suivre la marche que vous m’aviez indiquée, je fis faire une masse de fagots et après beaucoup d’efforts un foyer fut allumé et entretenu à l’entrée supérieure. […] À trois heures, l’incendie commença sur tous les points et jusqu’à une heure avant le jour le feu fut entretenu tant bien que mal afin de bien saisir ceux qui pourraient tenter de se soustraire par la fuite à la soumission ».
Cette précision permet d’affirmer que le feu intense dura de l’ordre de 14 à 15 heures (de 3 heures de l’après-midi à 5 ou 6 heures du matin – « une heure avant le jour »). Pélissier rendait également compte des armes saisies : 60 fusils, une douzaine de sabres, quelques pistolets et quelques lames de baïonnettes françaises. Rappelons que la colonne Pélissier comptait 2 254 hommes armés, donc autant de fusils, plus des pièces d’artillerie.
On imagine que, comme celle de Cavaignac l’année précédente, les autorités auraient volontiers masqué à l’opinion l’enfumade du Dahra. Mais deux témoignages fuitèrent. Le premier fut le rapport Pélissier lui-même : envoyé d’abord à Alger, il fut immédiatement transmis à Paris. Canrobert, candide, donna l’explication : « Si le maréchal Bugeaud avait été à Alger, il eût arrêté le rapport ; mais il était en expédition. » Mais il y avait une faille plus importante encore dans la volonté de masquer le drame : Pélissier avait eu la maladresse d’accepter un observateur étranger, un officier espagnol, non nommé dans les sources, qui assista à la scène et envoya son témoignage au quotidien madrilène, très lu, Heraldo. Ce texte, repris par la presse française à partir du 12 juillet, devint le support de l’accusation. L’officier fit partie du premier groupe, une soixantaine d’hommes, qui pénétra dans les grottes après le drame :
« À l’entrée se trouvaient des animaux morts, déjà on putréfaction, et enveloppés de couvertures de laine qui brûlaient encore. On arrivait à la porte par une traînée de cendre et de poussière d’un pied de haut, et de là nous pénétrâmes dans une grande cavité de trente pas environ. Rien ne pourrait donner une idée de l’horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu’ils avaient dû éprouver avant d’expirer. Le sang leur sortait par la bouche. Mais ce qui causait le plus d’horreur, c’était de voir des enfants à la mamelle gisant au milieu des débris de moutons des sacs de fèves, etc. On voyait aussi des vases de terre qui avaient contenu de l’eau, des caisses, des papiers et un grand nombre d’effets. »
Les odeurs pestilentielles étaient si insupportables, précisa-t-il encore, que les soldats durent se déplacer « d’une demi-lieue » (de l’ordre de 2 kilomètres) pour pouvoir respirer normalement. Le terrain était libre pour « les corbeaux et les vautours […] que, de notre campement, nous voyions emporter d’énormes débris humains ».
Au total, combien y eut-il de victimes ? On peut imaginer qu’en ces temps de mépris pour les indigènes, l’état-major de la colonne ne prit guère le temps de compter précisément les cadavres : l’acte accompli, la troupe repartit. Pélissier, dans son rapport, avança une estimation : « plus de cinq cents ». L’officier espagnol contesta ce chiffre : « Le nombre des cadavres s’élevait de 800 à 1 000 ». Une étude ultérieure confirme une fourchette haute : « entre 700 et 1 200 personnes ».
Cet épouvantable drame fut l’occasion d’une polémique, probablement la plus intense de toute la première guerre d’Algérie. Dès le 11 juillet, un débat, vif, se déroula à la Chambre des Pairs. Un ancien officier de l’armée d’Afrique, Napoléon-Joseph Ney, second prince de la Moskowa (1803-1857), fils du célèbre maréchal, qualifia cet épisode de « récit inouï, sans exemple et heureusement sans précédent dans notre histoire militaire » (ce « sans précédent » était quelque peu aventureux). Il fustigea « un colonel » (non nommé) pour avoir commis un acte « d’une cruauté inexplicable, inqualifiable ». Le prince employa la formule la plus adéquate : il s’était agi d’un « meurtre consommé avec préméditation sur des Arabes réfugiés sans défense ». Le maréchal Soult répondit avec embarras, au milieu de protestations : « Pour le fait lui-même, le Gouvernement le désapprouve hautement », mais tempéra cette désapprobation par la pénurie de renseignements – ce qui était un mensonge, il était en possession d’un rapport détaillé de Bugeaud depuis le 25 juin. Soult fut ensuite apostrophé par le comte de Montalembert (1810-1870) : « Le mot de désapprouver dont vient de se servir monsieur le maréchal est trop faible pour un attentat pareil ». Soult reprit alors la parole : « Si l’expression de désapprobation que j’ai employée au sujet du fait dont il est question est insuffisante, j’ajoute que je le déplore ».
Contrairement à d’autres exactions contemporaines, la presse rendit compte avec précision – et effroi – de cette enfumade. La société française fut un temps secouée. L’Algérie, courrier d’Afrique, périodique publié en métropole, dénonça la mort de « cinq cents martyrs », La Réforme évoqua « l’acte de barbarie le plus atroce dont l’histoire fasse mention », Le National fit un parallèle (audacieux) avec les officiers d’antan qui n’auraient jamais procédé de la sorte, Le Courrier français dit que cette « grillade » avait été « commise de sang-froid, et sans nécessité », etc. Christian Pitois, qui avait été peu de temps auparavant secrétaire particulier de Bugeaud, se brouilla avec lui et publia un ouvrage décrivant entre autres le drame, avec une gravure due à l’illustrateur renommé Tony Joannot (1803-1852). Plus tard, Victor Hugo, pour illustrer la « férocité » de l’armée française en Algérie, donna comme exemple « Colonel Pélissier, les Arabes fumés vifs » (15 octobre 1852). Outre Pélissier, la principale cible de la protestation fut, logiquement, Bugeaud. Le Charivari, journal satirique d’opposition, s’en prit à « M. Bugeaud, l’ordonnateur des brûleries du Dahra » (27 juillet), responsable de « cet horrible événement du Dahra, qui est comme la rue Transnonain de l’Afrique » (28 juillet).
Zaatcha ou la destruction totale d’une ville fortifiée, juillet-novembre 1849
La reddition quasi simultanée d’Abd el-Kader (décembre 1847) et d’Ahmed bey (janvier 1848) put faire croire un instant aux Français que c’en était fini des combats en Algérie. Il n’en fut rien. Dans le Sud-Constantinois, près de Biskra, Ahmed Bû Zyân, dit le cheikh Bouziane, prêcha la révolte, commença à lever des troupes et fut bientôt appelé le Mahdi* (réputé de la famille du Prophète). L’armée française, envoyée en hâte, Bouziane se réfugia dans l’oasis de Zaatcha. Le terme oasis peut d’ailleurs être trompeur ; il ne s’agissait nullement de quelques palmiers répartis autour d’un point d’eau, mais d’une véritable ville fortifiée de 12 kilomètres de périmètre, à l’abri d’une muraille et d’un fossé empli d’eau de 6 à 8 mètres de large. Les premières troupes envoyées en juillet 1849 contre les insurgés, le 2e régiment de la Légion, commandées par le colonel Carbuccia (1808-1854), pensaient pouvoir enlever la place en quelques jours. Elles furent accueillies par une pluie de balles et durent reculer, après avoir subi de fortes pertes. Il semble que, trompé lui-même par ce mot de « oasis », le colonel ignorait qu’il y avait des fortifications. L’état-major prit alors – enfin – la mesure de la résistance et envoya une nouvelle colonne de 3 300 hommes, commandée par le général Herbillon, commandant de la province de Constantine, ensuite rejointe par deux autres colonnes, commandées par les colonels de Barral et Canrobert, en tout 4 500 combattants. Herbillon arriva à Zaatcha le 7 octobre « avec la persuasion que les habitants ne résisteraient pas à nos armes (fut) frappé de les voir tenaces et persévérants dans la défense et audacieux dans leurs attaques », selon ses propres termes.
Un épisode tragi-comique déstabilisa un temps la garnison, puis alimenta quelques quolibets en métropole. Une personnalité, Pierre-Napoléon Bonaparte (1815-1881), fils de Lucien et donc neveu de l’empereur déchu, se joignit au campement mais, peut-être surpris par l’âpreté du combat, n’y resta pas et repartit pour la France sans même passer par Alger (ce fut ce même Bonaparte qui, en janvier 1870, assassina le journaliste Victor Noir).
Le siège commença. Un premier assaut eut lieu le 20 du même mois, mais il échoua.
À ce moment, un autre acteur, non invité, compliqua considérablement la situation : le choléra, apporté par la colonne Canrobert. Certains soldats moururent avant même d’atteindre le lieu du combat… et les autres contaminèrent leurs camarades déjà sur place. « À chaque instant on entendait les plaintes des malheureux soldats que venait frapper le fléau. Leurs cris mêlés au bruit continuel des coups de feu, au mugissement sourd des palmiers toujours agités par les vents, jetait dans tous les cœurs la plus profonde tristesse. »
Les officiers préparèrent malgré tout l’assaut final. L’une des pratiques fut l’abattage de 10 000 palmiers, afin de dégager le terrain. La puissance de feu des assaillants était impressionnante. Mais en face, il y avait également des centaines de combattants, armés (dont certains fusils pris aux Français lors des assauts précédents), ayant l’énergie du désespoir, retranchés dans des lieux qu’ils connaissaient parfaitement.
L’assaut commença le 26 novembre à huit heures. On imagine l’état d’esprit des troupes : quatre mois de siège impuissant, à coucher par terre dans des conditions pénibles, des camarades tombant autour d’eux à chaque tentative d’approche, des informations sur le sort des quelques Français prisonniers ou des blessés abandonnés lors des assauts précédents (tortures, décapitations, émasculations). Et, danger permanent, les ravages du choléra. L’heure de la vengeance avait sonné. Ce fut un « carnage », comme le décrivit un très jeune officier, Charles Bourseul (1829-1912) :
« Les rues, les places, les maisons, les terrasses sont partout envahies. Des feux de peloton couchent sur le sol tous les groupes d’Arabes que l’on rencontre. Tout ce qui reste debout dans ces groupes, tombe immédiatement sous la baïonnette. Ce qui n’est pas atteint par le feu, périt par le fer. »
Pourtant, le courage face à la mort des habitants, combattants et civils confondus, impressionna les Français. Ce même officier alla même jusqu’à une forme de respect pour les défenseurs :
« Pas un seul des défenseurs de Zaatcha ne cherche son salut dans la fuite, pas un seul n’implore la pitié du vainqueur, tous succombent les armes à la main, en vendant chèrement leur vie, et leurs bras ne cessent de combattre que lorsque la mort les a rendus immobiles. Ceux qui sont embusqués dans les maisons crénelées font sur nous un feu meurtrier, qui ne s’éteint pas même lorsque ces maisons sautent par la mine ou s’écroulent par le boulet. Ensevelis sous leurs ruines, les Arabes tirent encore, et leurs longs canons de fusil, passant à travers les décombres, semblent adresser aux vainqueurs une dernière vengeance et un dernier défi. »
Le cœur de la résistance, la maison de Bouziane, fut l’objet d’une canonnade intense. Lorsqu’elle s’effondra, les rescapés firent sur les assaillants « une décharge, la dernière ! Puis, abordés à la baïonnette, ils tomb[èr]ent les armes à la main, frappés par devant comme s’honoraient de l’être les guerriers de l’antiquité ». Cependant, Bouziane et l’un de ses fils, 15 ans, qui avait combattu, ainsi que Si Moussa, considéré comme le marabout, furent pris vivants. Le général Herbillon ordonna leur exécution. L’adolescent ne fut pas épargné. Ils furent tous trois passés par les armes « avec une cinquantaine d’autres Arabes ». L’ouvrage d’Herbillon, plus tard, évita d’évoquer cette répression contre des combattants vaincus et désarmés. Il expédia le fait d’une seule phrase : « Le chef des rebelles est passé par les armes », concédant quelques lignes plus loin que son fils avait été tué également, avec comme épitaphe : « Le louveteau ne deviendra pas loup. »
Que faire des cadavres des trois principales victimes ? Ils furent comme de coutûme décapités. Leurs têtes furent placées au bout de trois piques, puis déposées et restèrent sur place durant 48 heures, enfin furent transférées et exposées sur le marché de Biskra, on imagine dans quel état, afin une fois de plus d’impressionner les populations locales. Les crânes ont été ensuite envoyés en France, où ils furent entreposés, avec d’autres, dans les sous-sols du musée de l’Homme.
Pourtant, ce n’était pas encore totalement terminé. Des tireurs isolés poursuivirent ce combat désespéré jusqu’à trois heures de l’après-midi : le combat dura donc sept heures. Ce qui eut le don d’exaspérer plus encore les soldats français. Un massacre ininterrompu (re)commença. La mère, la femme, la fille et le fils cadet de Bouziane furent exécutés dans la maison familiale. La population fut passée au fil de l’épée – ou, le plus souvent, de la baïonnette. Le général Herbillon se crut obligé de fournir cette précision : « Un aveugle et quelques femmes furent seuls épargnés ». Charles Bocher évalua à « à peine une vingtaine » de femmes épargnées, « la plupart blessées portant leurs enfants au sein ». La destruction de la ville fut totale, méthodique. Les maisons qui restaient encore debout furent minées, De même pour les deux mosquées de la ville, pour « prouver aux Arabes que leur Dieu qu’ils invoquaient contre nous ne pouvait désormais les protéger dans leur révolte ». La végétation restante fut rasée.
Les pertes totales de la population algérienne sont difficilement chiffrables. Les témoignages cités supra amènent à penser qu’il put y avoir 2 000 victimes. Le 7 décembre, le général d’Hautpoul (1754-1807), ministre de la Guerre, annonça la nouvelle aux députés : « Les 800 hommes qui étaient dans la place se sont fait tuer jusqu’au dernier ». Oui, « 800 hommes », mais il n’eut pas un mot sur les femmes, enfants et vieillards également morts. Les pertes françaises furent minimisées par le même ministre : 40 morts et 150 blessés. En réalité, elles furent plus importantes que dans la plupart des assauts de cette période : 570 morts (dont 250 du choléra) et 680 blessés, probablement les plus importantes depuis l’échec du premier assaut sur Constantine en 1836 et de Sidi-Brahim en 1845.
Lorsque les circonstances du drame furent connues en France, la réaction fut classique : la plus grande partie du monde politique et de la presse salua ce « glorieux fait d’armes ». Les morts des assiégés furent attribuées à leur fanatisme, thème classique. « Les défenseurs de Zaatcha s’étaient recrutés parmi les hommes les plus fanatiques », affirma Le Moniteur algérien, apportant une preuve irréfutable : « On croit même qu’il y avait quelques gens de La Mecque ». Mais, sous les phrases ronflantes et triomphatrices, l’inquiétude perçait : « Il est permis de croire que l’Algérie pourra se reposer quelque temps sur ce succès » affirma le très officiel Moniteur algérien (20 décembre 1849). Il y avait dans ce « quelque temps » autant de réalisme que d’appréhension.
Le drame de Zaatcha est totalement oublié en France. Par contre, si la mémoire algérienne ne bénéficia pas de l’arme de l’écriture, elle garda une place de choix pour les martyrs, en particulier pour Bouziane et son fils.
Source : Histoire coloniale et postcoloniale – 01/03/2025 https://histoirecoloniale.net/y-eut-il-des-oradour-algeriens-durant-la-conquete-quelques-faits-incontournables/