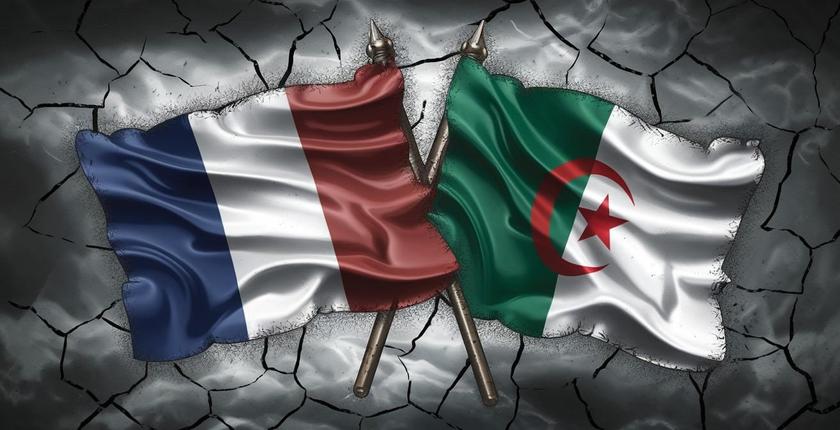La droite et l’extrême droite en France ne comptent pas lâcher prise lorsqu’il s’agit de l’Algérie. Encore une fois, les accords algéro-français de 1968 sont remis sur la table dans un seul objectif : maintenir délibérément une stratégie de tension dans les relations entre Alger et Paris.
Selon le quotidien Le Figaro, le Rassemblement national (RN) va présenter devant l’Assemblée une résolution pour dénoncer ces accords à l’occasion de la tenue de la niche parlementaire du parti le 30 octobre. La niche parlementaire en France est le moment que tous les groupes d’opposition attendent pour se projeter au cœur de l’actualité politique.
Un jour par mois, durant la session ordinaire, un groupe d’opposition fixe ainsi l’ordre du jour du Parlement. Il est, toutefois, assez rare qu’une résolution ou un projet de loi soient adoptés lors d’une niche parlementaire. Précisons qu’une résolution votée dans l’hémicycle n’a pas force de loi : elle exprime bien une position politique du Parlement, mais ne peut contraindre le gouvernement à faire passer une loi en ce sens.
Eric Ciotti, président de l’Union des droites (UDR), a, en ce sens, affirmé : « On aura un débat la semaine prochaine ouvert par le Rassemblement national pour abroger les accords de 1968. Chacun devra prendre ses responsabilités. » La niche parlementaire du RN prévoit, entre autres, l’examen d’une résolution portée par le député Guillaume Bigot visant à dénoncer ces accords. Pour le média français, cette démarche «revêt une signification particulière» une semaine après la publication d’un rapport parlementaire sur les «coûts (…) résultant de ces accords»* (ci-après).
S’en est suivi alors un flot de commentaires sur les conclusions d’un rapport qui s’inscrit nettement dans une démarche qui consiste à fustiger l’immigration algérienne de France. Depuis des mois, l’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, non-reconduit dans le gouvernement Lecornu 2, n’a cessé, lui en particulier, de réclamer la dénonciation de ces accords.
« Coquille vide »
« Si demain la droite arrive au pouvoir, on abolira les accords de 1968 », avait-t-il lancé en mars. Son successeur à la place Beauvau n’est pas du même avis. Le nouveau ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez, se positionne contre une remise en cause de ces accords, qui «n’est pas à l’ordre du jour», a-t-il déclaré. « Il y a ces accords, ils fonctionnent, ils ne sont pas complètement parfaits, je vous le concède, mais pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour », a-t-il expliqué sur France Info il y a quelques jours. Nunez a, aussi, exprimé à plusieurs reprises, depuis sa prise de fonction, son désir d’engager une politique de dialogue avec l’Algérie.
Face à lui, les courants de la droite et de l’extrême droite s’agitent. Fin septembre, les chiffres relatifs au nombre de visas accordés par la France aux étudiants algériens déclenche l’ire d’élus de la droite et de certains élus RN. Au total, 8351 visas ont été délivrés pour la rentrée 2025, soit plus d’un millier de plus en un an, une hausse dont l’ambassade de France à Alger s’est publiquement félicitée. En réaction, Eric Ciotti a violemment chargé les autorités française en les qualifiant de « gouvernement tartuffe ». De son côté, l’eurodéputée Reconquête Sarah Knafo a appelé à supprimer tous « les avantages accordés » par la France à l’Algérie.
En somme, un déferlement de propos haineux et disproportionnés devenus courants dans la bouche des nostalgiques de l’Algérie française. Côté algérien, la dénonciation de ces accords n’est pas envisageable. La positon d’Alger, sur ce dossier, reste inflexible.
Le président Tebboune a, d’ailleurs, réaffirmé cette position dans un entretien accordé en février au journal français L’Opinion. « Pour moi, c’est une question de principe. Je ne peux pas marcher avec toutes les lubies », a-t-il répondu à une question sur les appels lancés par plusieurs politiques français pour exiger la dénonciation des accords de 1968. « Pourquoi annuler ce texte qui a été révisé en 1985, 1994 et 2001 ? »
« Ces accords étaient historiquement favorables à la France qui avait besoin de main-d’œuvre. Depuis 1986, les Algériens ont besoin de visas, ce qui annule de fait la libre circulation des personnes telle qu’elle est prévue dans les accords d’Evian », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Ces accords sont une coquille vide qui permet le ralliement de tous les extrémistes comme du temps de Pierre Poujade.»
Source : El Watan- 25/10/2025 https://elwatan-dz.com/accords-de-1968-lextreme-droite-francaise-revient-a-la-charge
*Un rapport parlementaire français propose la dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968
En France, deux députés du camp présidentiel ont dévoilé mercredi matin « pour éclairer le débat », un rapport sur le coût des accords entre la France et l’Algérie. Soutenus par l’ancien Premier ministre, Gabriel Attal, dans leur démarche, les deux élus pointent du doigt l’accord franco-algérien de 1968, qu’il faut, selon eux, dénoncer.
Cet accord avait été signé six ans après la fin de la guerre d’Algérie, alors que la France avait besoin de bras pour soutenir son économie. Ce rapport adresse plusieurs reproches à l’accord de 1968. Le premier d’entre eux, c’est que le statut dérogatoire dont bénéficient les Algériens porterait atteinte au principe d’égalité entre les étrangers.
« Un citoyen guinéen ou sénégalais, il doit attendre 18 mois pour bénéficier du regroupement familial contre 12 mois pour un Algérien », constate le député Ensemble pour la République, Charles Rodwell.
Deuxième enseignement, c’est que la France serait la seule des deux parties à continuer d’appliquer le texte. « Pour un Algérien qui a travaillé 40 ans, 20 ans en Algérie et 20 ans en France, l’accord dit que la France doit lui verser la moitié de sa pension. L’Algérie doit verser l’autre moitié de la pension. La Sécurité sociale algérienne ne verse pas cette pension, c’est la France qui compense », poursuit Charles Rodwell.
Deux milliards d’euros, le coût pour le contribuable français
Le rapport estime à au moins 2 milliards d’euros, chaque année, le coût de l’accord pour le contribuable français. Un chiffrage « très peu étayé » critique la gauche, qui parle d’un rapport plus politique que financier. « Le Général de Gaulle souhaitait que le statut des Algériens soit spécifique en raison de leur appartenance à la nation française durant 132 ans. Il n’est pas totalement incompréhensible que des gens qui ont partagé un destin commun avec la France voient leur statut être régi de manière spécifique », estime le député socialiste Philippe Brun.
« L’ abrogation de cet accord ouvrirait une nouvelle page de l’histoire commune entre la France et l’Algérie », affirment au contraire les auteurs du rapport, qui espèrent que le président de la République entendra leur demande.
L’accord-cadre franco-algérien de 1968 et ses avenants
Les relations entre la France et l’Algérie sont dans un moment de fort tension au point que le dossier migratoire, pourtant en veilleuse, est revenu sur le tapis. Il a été remis sous le feu des projecteurs en 2023 à la faveur d’un rapport à charge pour l’Algérie de l’ancien ambassadeur Xavier Driencourt. Un rapport destiné au centre de réflexions Fondapol, très marqué à droite, et publié peu après la sortie en librairie de ses mémoires algériennes (L’Énigme algérienne. Chroniques d’une ambassade à Alger, auxÉditions de l’Observatoire, 2022) qu’il conclut en ces termes : « Nous avons trop souvent tendu l’autre joue après avoir reçu une gifle. » Un rapport venu nourrir la volonté exprimée depuis plusieurs mois par des responsables politiques de droite (l’ex-ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau mais aussi les ex-Premiers ministres Edouard Philippe et Gabriel Attal, ou encore Marine Le Pen) de dénoncer l’accord-cadre de 1968.
► L’ accord-cadre de décembre 1968
Signé par Jean Basdevant, haut représentant envoyé par de Gaulle en Algérie, et Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, cet accord à la négociation duquel a activement participé le diplomate et ancien résistant Stéphane Hessel, alors ministre-conseiller à Alger, restreint les dispositions des accords d’Évian de 1962 qui prévoyaient la libre circulation et installation des personnes d’Algérie vers la France, Algériens comme Français. La libre circulation entre les deux pays avait déjà été freinée avant cette date en raison de l’entrée importante d’Algériens sur le sol français en 1962 : la clause de libre circulation des Accords d’Évian est suspendue en 1964 (accords Nekkache-Grandval). Et dans l’accord-cadre de 1968 un certificat de résidence est imposé aux Algériens. Ce certificat est l’équivalent des cartes de séjour destinées aux étrangers du régime général. Ils peuvent l’obtenir après trois ans de résidence (et non cinq pour les autres ressortissants hors UE) et il est valable dix ans. En cas de regroupement familial, les membres de la famille reçoivent une carte de résident de la même durée que le titre de la personne qu’ils rejoignent. En outre, les Algériens peuvent s’installer à leur compte dans une activité libérale sans autre formalité.
Mais les Algériens subissent des contraintes spécifiques. Ainsi, les étudiants peuvent moins travailler (à mi-temps, au lieu de 60 % du temps de travail pour les autres nationalités) et doivent obtenir une autorisation de travail.
► Plusieurs avenants
Au cours des années suivantes, cet accord-cadre de 1968 a été amendé à trois reprises : en 1985, 1994 et 2001. Ces trois modifications ont rapproché la situation des ressortissants algériens des dispositions de droit commun. Après l’amendement de 1985, les Algériens sont soumis à l’obtention d’un visa pour entrer sur le territoire français. Après celui de 1994, le certificat de résidence d’un ressortissant algérien périme si ce dernier passe plus de trois ans consécutifs hors du territoire français, disposition qui s’applique aussi dans le droit commun. Enfin, en 2001, un dernier accord instaure des passe-droits — en particulier hospitaliers – destinés à l’élite algérienne.
En 2007, un aménagement (de niche) signé par Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, et par Mourad Medelci, son homologue algérien, et destiné à faciliter la circulation de détenteurs de passeports diplomatiques en les exemptant de visa, a été « suspendu » par le ministre de l’Intérieur le 17 mars dans le cadre de la « réponse graduée » aux autorités algériennes, répliquant à leur refus d’accueillir leurs ressortissants expulsés du sol français.
Par ailleurs, comme l’accord-cadre de 1968 relève du droit international qui prime sur le droit français, les Algériens vivant en France ne sont pas soumis aux dernières lois (qu’elles soient favorables ou défavorables pour les migrants) votées sur l’immigration depuis 2001. Ils sont ainsi exclus de dispositifs tels que le « passeport talents », qui répond au concept vanté par Nicolas Sarkozy d’une « immigration choisie », ou encore à la régularisation par le travail qui doit passer par le seul exercice d’un métier dit « en tension » ou pour raison humanitaire. « Quand vous mettez tout dans la balance, les ressortissants algériens perdent plus qu’ils ne gagnent et ils auraient intérêt à renégocier ce traité », juge le professeur de droit public Serge Slama.
► Alger prié de « réexaminer » les accords
La question de l’immigration de travail doit être replacée dans le contexte plus général des relations franco-algériennes. Entre l’affaire Boualem Sansal, le dossier du Sahara occidental, les arrestations récentes d’influenceurs, l’attaque mortelle perpétrée à Mulhouse fin février 2025 par un ressortissant Algérien sous obligation de quitter le territoire français (OQTF), a été le détonateur de la résurgence du débat sur l’accord franco-algérien de 1968. À l’issue d’un comité interministériel mercredi 26 février 2025, le gouvernement français annonce demander à Alger de « réexaminer » la totalité des accords sur l’immigration et ce, dans un délai de quatre à six semaines.
► Que se passerait-il en cas de dénonciation de l’accord-cadre ?
En droit international, seul le président peut dénoncer ou ratifier des traités. « Quand on dénonce un accord international, on n’est pas tout seul à interpréter ses conséquences, explique le politologue Patrick Weil, pour qui une dénonciation serait une erreur. En France, le sénat affirme que les Algériens seraient soumis au droit commun, mais les Algériens, eux, estiment que l’on reviendrait aux accords d’Évian. Dans une situation de tension et de crise, l’Algérie pourrait décider de se replacer immédiatement dans l’esprit des accords d’Évian, et inciter ses ressortissants à se rendre massivement en France. Que ferait la France ? Elle n’a pas intérêt à se placer dans une situation d’incertitude dont la sortie dépendra moins d’elle encore qu’aujourd’hui. »
► Pour aller plus loin
« Les instruments internationaux en matière migratoire » (rapport du Sénat de février 2025)
L’ Histoire secrète des accords d’Alger, François-Guillaume Lorrain, Le Point du 17 avril 2025
« Dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 serait une surenchère malvenue dans une conjoncture politique déjà abîmée » (Tribune de Hocine Zeghbib dans Le Monde du 16 janvier 2025)
Source : RFI – 15/10/2025 https://www.rfi.fr/fr/france/20251015-un-rapport-parlementaire-fran%C3%A7ais-propose-la-d%C3%A9nonciation-de-l-accord-franco-alg%C3%A9rien-de-1968