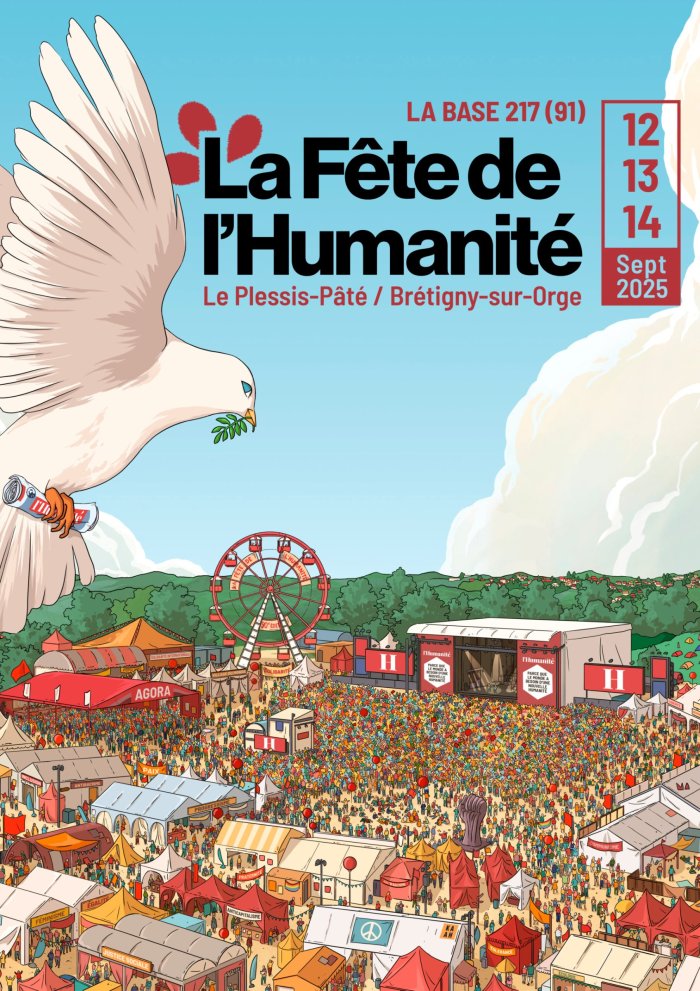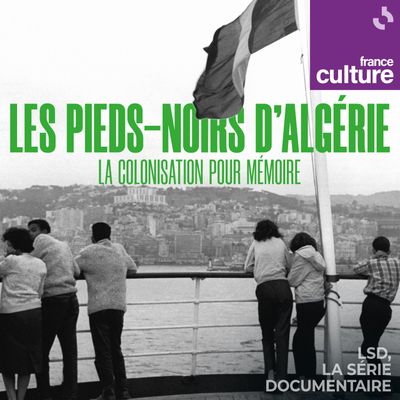La kabylophilie brandie par « Le Point » et Kamel Daoud a des origines coloniales bien connues.
Dans son numéro du 14 août 2025, l’hebdomadaire Le Point publie un dossier intitulé « Les Kabyles, un peuple debout », comportant notamment un texte de l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Ne reculant devant aucune essentialisation, ce dernier y développe l’idée que les Kabyles représenteraient « une autre Algérie, anti-islamiste, réformatrice ». Ressurgit ainsi une fois de plus un poncif bien connu des historiens de l’Algérie coloniale : l’opposition du bon kabyle proche de l’Occident et de l’Arabe fanatique et archaïque. Le « fameux “mythe kabyle”, forgé sous la Ille République pour tenter de mater les musulmans d’Algérie rétifs à la domination coloniale », selon les termes de Vincent Geisser et Aziz Zemouri dans un ouvrage paru en 2007 dont nous publions ci-dessous un extrait. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur le mythe colonial berbère et l’épisode du « Dahir berbère » au Maroc.
Le mythe colonial de l’exception kabyle
par Vincent Geisser et Aziz Zemouri
___________________________________
Extrait de l’ouvrage Marianne et Allah – Les politiques français face à la “ question musulmane” de Vincent Geisser & Aziz Zemouri (La Découverte, 2007)
Kabyles démocrates contre musulmans fanatiques
Pour la plupart des médias français, Idir est un chanteur kabyle et Souad Massi une chanteuse algérienne. Certes, le premier chante en tamazight (et en français) et la seconde en arabe (et en français), mais tous deux sont originaires du même pays, l’Algérie. Curieux distinguo qui laisse à penser qu’un Kabyle ne serait pas Algérien. De quoi faire se retourner dans leur tombe tous les militants kabyles de la première heure qui combattirent en faveur de l’indépendance de l’Algérie, dès les années 1920, au sein de l’Étoile nord-africaine, majoritairement kabyle, puis dans les rangs du FLN. Pourtant, le distinguo semble à géométrie variable : ainsi, on chercherait en vain dans la presse française la mention de l’origine kabyle de « méchants » avérés, comme le général-major Mohammed Médiène, dit « Tewfik », patron depuis 1990 du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), l’ex-Sécurité militaire, ou le général-major Mohammed Touati, tous deux symboles de l’« Algérie des généraux ». Comme s’il était impensable pour certains « spécialistes » de la question algérienne qu’un Kabyle puisse être ailleurs que dans le camp des « gentils ».
De même, on « oublie » qu’un bon tiers de la direction du Front islamique du salut (FIS) algérien était originaire de Kabylie, où ce parti a obtenu 25 % des voix lors des élections législatives de 1991 ; mais, pour la polémiste Caroline Fourest, c’est leur origine kabyle qui rendrait allergiques à toute concession politique envers les « intégristes » des personnalités françaises comme Malek Boutih, ancien porte-parole de SOS-Racisme, ou Fadéla Amara, présidente de Ni putes ni soumises, une « jeune femme d’origine kabyle qui lutte contre l’obscurantisme [2] ». Un cliché devenu vérité d’évidence dans la France médiatique des années 1990 et 2000, notamment depuis le best-seller Une Algérienne debout (1995) de la très « éradicatrice » militante kabyle Khalida Messaoudi [3] devenue depuis ministre de la Culture du gouvernement de la « concorde civile ».
À lire le portrait de Fadéla Amara brossé en 2003 par Libération [4], on ne peut s’empêcher de penser à cette phrase du député radical Camille Sabatier, en 1882 : « C’est par la femme qu’on peut s’emparer de l’âme d’un peuple. » Mais la mémoire est oublieuse : peu férus d’histoire, les hérauts français contemporains des Kabyles défenseurs de la « laïcité républicaine » face au « fascisme vert » de l’islamisme ignorent sans doute qu’ils perpétuent le fameux « mythe kabyle », forgé sous la Ille République pour tenter de mater les musulmans d’Algérie rétifs à la domination coloniale.
L’ invention coloniale du Kabyle démocrate, blond aux yeux bleus
Ainsi, André Santini, député-maire UDF d’Issy-les-Moulineaux, ou Claude Goasguen, conseiller UMP de Paris et député sarkozyste, compagnons de route des Berbères de France, dont ils relaient les revendications à l’Assemblée nationale, ne font pas mystère de leur engagement berbériste. Selon André Santini, « les Berbères sont des laïcs, ils pratiquent un islam modéré. Ils ont un caractère tolérant, ils ont notre conception de la laïcité. Ils se regroupent sans être arro- gants et ne sont pas envahissants [5] ». Et, pour Claude Goasguen, « ils ont un culte musulman moins intégriste que les autres, car ils ont été islamisés plus tardivement [6] ». Pour l’un et l’autre, qui partagent en l’espèce le même credo que les « intégralistes » de la laïcité à gauche, l’imaginaire compte plus que la réalité. Peu leur importe que la wilaya (préfecture) de Tizi-Ouzou, capitale de la Grande Kabylie, compte aujourd’hui le plus grand nombre de mosquées en Algérie (731 sur 15 000), ou que l’islam kabyle soit extrêmement conservateur et relativement imperméable à tout esprit de réforme [7].
Il est donc difficile de ne pas voir dans ces propos un écho, plus ou moins conscient, des théories et pratiques coloniales forgées lors de la conquête française de l’Algérie. L’utilisation du berbérisme contre l’islam est en effet une vieille idée qui puise son origine dans cette histoire. Et il faut revenir aux travaux de l’historien Charles-Robert Ageron, dont la thèse parue en 1968 reste une référence incontournable, pour comprendre les fins de la création du mythe kabyle [8].
Ce mythe repose à la fois sur des considérations identitaires et religieuses : aux premières décennies de la conquête et jusqu’à la fin du siècle, la Kabylie fut l’objet de tentatives d’évangélisation et d’instrumentalisation politico-religieuse. Pour démontrer qu’ils sont différents des Arabes et proches des Européens, on leur attribue une ascendance nordique, voire aryenne. C’est par exemple un texte posthume attribué à l’abbé Raynal, l’Histoire philosophique des établissements dans l’Afrique septentrionale, paru en 1826 : « Les Kabyles sont d’origine nordique, en descendance directe des Vandales, ils sont beaux avec les yeux bleus et des cheveux blonds, leur islam est tiède. » Tocqueville écrivait en 1847 que « le pays kabyle nous est fermé, mais l’âme kabyle nous est ouverte ». La Grande Kabylie : études historiques d’Eugène Daumas, parue en 1847, n’est pas en reste : « Le peuple kabyle est en partie germain d’origine, après avoir connu le christianisme. Il a accepté le Coran, mais ne l’a pas embrassé. Contrairement aux résultats universels de la foi islamique, en Kabylie nous découvrons la sainte loi du travail obéie, la femme à peu près réhabilitée, nombre d’usages où respire la commisération chrétienne. » Le baron Henri Aucapitaine écrit dans son ouvrage, Le Pays et la Société kabyles, publié en 1857 : « Dans cent ans, les Kabyles seront Français. » Selon le docteur Auguste Warnier, élu député d’Alger après avoir servi le gouvernement : « Pour le Kabyle, la femme est d’abord une mère de famille et non une bête de somme comme dans la société arabe [9]. »
Malgré l’insurrection de 1871, les panégyristes kabylophiles demeuraient sur leurs préjugés : on accusait les confréries musulmanes d’avoir manipulé les insurgés de la révolte de Mokrani, laissant ainsi penser que sans l’islam les Kabyles auraient accepté la domination française sans réagir. Les historiens s’accordent pourtant sur le fait que c’est bien le cheikh Mokrani qui a sollicité la zaouia Rahmaniyya, confrérie religieuse, afin de lancer le djihad contre l’occupant, et non le contraire. Cet épisode n’empêcha pas l’archevêque d’Alger, Charles Martial Lavigerie, de penser que la Kabylie était le « Liban de l’Afrique », autrement dit un pays chrétien au coeur du Maghreb musulman [10].
Un des éléments du continuum colonial qui caractérise le mythe kabyle, c’est donc son aspect religieux. Encore aujourd’hui, la berbérophilie des politiques ou des intellectuels français, aussi laïques et républicains soient-ils, se mesure aux effets de l’évangélisation tentée dans les années 1870 par les Pères blancs : les Kabyles de France seraient plus intégrables que les autres populations originaires du Maghreb, parce qu’ils seraient supposés entretenir une plus grande proximité avec la « culture judéo-chrétienne ». Un argument quelque peu surprenant pour des intellectuels laïcistes qui prétendent lutter contre le communautarisme à l’école républicaine…
Pourtant, les témoignages de la fin du xixe siècle abondent sur la résistance des populations kabyles contre ces tentatives de christianisation. Belqacem ben Sedira, un auteur de nationalité française, dans son ouvrage Une mission en Kabylie et l’assimilation des indigènes (1886), restitue les propos recueillis lors de son enquête : « Si on veut faire de nos enfants des petits roumis, nous n’avons plus qu’à construire une route pour aller nous jeter à la mer [11] » Si les Kabyles peuvent accepter la présence d’un « marabout chrétien », ils rejettent globalement son apostolat : « Nous préférerions voir mourir tous nos enfants plutôt que de les voir devenir chrétiens. » L’exemple des Aït-Ferah : « Nous ne renoncerons jamais à notre religion. Si le gouvernement veut nous y contraindre, nous lui demanderons de quitter le pays. »
Un conflit larvé opposait d’ailleurs militaires et religieux français à propos de la politique d’évangélisation des missions chrétiennes : consultés sur la question par l’administration coloniale en 1850, les militaires assuraient que cela causerait une « émotion dangereuse », amènerait une perturbation générale et se révélerait vain. Conformément aux prévisions de l’armée, on ne recensera aucune conversion au plus fort de l’activité des missions. Un échec imputé aux militaires : « Si on nous avait laissé faire, la Kabylie serait chrétienne », dira Lavigerie [12]. Les militaires étaient même accusés de favoriser l’islamisation à travers la création des Bureaux arabes [13], organismes créés conformément à la politique arabe de Napoléon III.
Un mythe n’ayant pas cours en métropole
Ce fameux mythe kabyle, s’il est alors opérant en Algérie, n’a toutefois pas cours en métropole. Dès le début du xxe siècle, les Kabyles immigrés sont traités de la même manière que tous les autres Nord-Africains : surveillés, méprisés par les pouvoirs publics, ils ne bénéficient d’aucun préjugé favorable, comme le rappelle Nedjma Abdelfettah, qui a analysé en détail les modalités d’encadrement de l’immigration algérienne à Paris de 1917 à 1952, majoritairement kabyle : « La lecture d’une étude de la Préfecture de police produite en 1952 sur la présence des populations nord-africaines à Paris [est très parlante]. Modèle du genre, ce rapport aurait pu être écrit vingt ans plus tôt, voire plus, à quelques détails près. Il reproduit une vision statique de la communauté nord-africaine à Paris, où ne change que le nombre qui va croissant. Le moule introduit dans les années 1920 et 1930, qui aurait pu être bouleversé par l’exercice même d’une observation extrêmement régulière, est toujours en place. Il est fondé sur une approche culturelle d’une sorte d’être nord-africain et de son comportement. Les thèmes sont quasiment donnés d’avance : la solidarité religieuse ou tribale, avec son revers la sujétion et l’exploitation, le sens de l’honneur avec son revers la culture de la vendetta et l’inadaptation à l’idée du droit, l’instinct grégaire obstacle à l’intégration dans la société d’accueil, le tribalisme et le lien religieux obstacles à l’existence de l’individu, […] les différences irréductibles de civilisations et de genres de vie qui vouent à l’échec les mariages mixtes (auxquels ne sont candidates que les femmes européennes diminuées physiquement ou socialement), les risques de contamination par toutes sortes de tares devant l’arrivée de petits Abdallah et Mohamed bel et bien français sur les bancs de l’école, le problème juridique que pose l’existence de ces petits êtres hybrides…
« En 1935, Octave Depont publie un livre pour saluer et justifier l’ouverture d’un hôpital spécialement destiné aux « Berbères immigrés », à qui la ville souhaite offrir un autre « signe d’amitié » en plus de la mosquée. Le bellicisme de l’islam et son caractère dépouillé côtoient le caractère primitif des Berbères. Depont, que Charles-Robert Ageron présente comme un berbérophile qui aurait travaillé à l’encouragement de l’immigration kabyle, dans une perspective assimilationniste, montre dans cet ouvrage que sa berbérophilie s’arrête aux frontières de l’Algérie, où elle a une fonction de division et d’opposition aux Arabes. À Paris, où il ne souhaite absolument pas les voir se multiplier, elle est rudement mise à l’épreuve. Le monde et l’être berbères sont décrits comme des repoussoirs qui suscitent rejet et répression : « Il y a, en effet, dans la psychologie des Berbères à la fois impulsifs et violents, arrogants et obséquieux, pillards redoutables, des contrastes et des contradictions qui ne se révèlent partiellement qu’à ceux que de patientes observations et de profondes connaissances des dialectes mettent à même de pénétrer l’âme des Nord-Africains. » Devant le fait accompli de leur présence, il appelle à un traitement qui les distingue. Un hôpital spécial se justifie donc pour lui par les « maladies à évolution assez particulière » des Nord-Africains [14] . »
Nedjma Abdelfettah montre ainsi que la berbérophilie et la kabylophilie françaises — cette dernière constituant une déclinaison coloniale de la première — fonctionnent de manière paradoxale : elles procèdent d’une forme de stigmatisation à la fois « positive » et « négative » des Berbères colonisés, visant à les différencier, ou au contraire à les rapprocher, des « moeurs arabes », mais toujours dans une optique de contrôle social et politique.
[1] Editions La Découverte, mars 2007, 20 €.
[2] Caroline FOUREST, La Tentation obscurantiste, Grasset, Paris, 2005.
[3] Khalida MESSAOUDI, Une Algérienne debout. Entretiens avec Élisabeth Schemla, Flammarion, Paris, 1995.
[4] Charlotte ROTMAN, « Soumission impossible », Libération, 26 février 2003.
[5] André Santini, entretien avec les auteurs, 2006.
[6] Claude Goasguen, entretien avec les auteurs, 2006.
[7] Kamel CHACHOUA, L’Islam kabyle. Religion, État et société en Algérie, Maisonneuve & Larose, Paris, 2002.
[8] Charles-Robert AGERON, « Le « mythe kabyle » et la politique kabyle », Les Algériens musulmans et la France, tome I, PUF, Paris, 1968, p. 267-292 ; « La politique kabyle de 1898 à 1918 », tome II, p. 873-890.
[9] Toutes les citations qui précèdent sont extraites du chapitre de Charles-Robert AGERON, « Le « mythe kabyle » et la politique kabyle (1871-1891) », loc. cit.
[10] Ibid., p. 273.
[11] Ibid., p. 275.
[12] Ibid., p. 274.
[13] Jacques FRÉMEAUX, Les Bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, Denoél, Paris, 1993.
[14] Nedjma ABDELFETTAH, « « Science coloniale » et modalités d’encadrement de l’immigration algérienne à Paris (1917-1952) », Bulletin de l’IHTP, n° 83, juin 2004.
Source : Orient XXI – Édition du 1er au 15 septembre 2025 https://histoirecoloniale.net/le-bon-kabyle-face-a-l-arabe-fanatique-un-vieux-mythe-colonial/