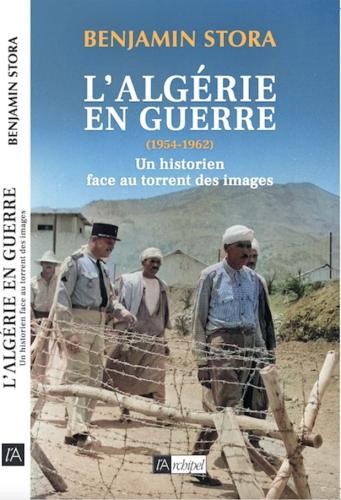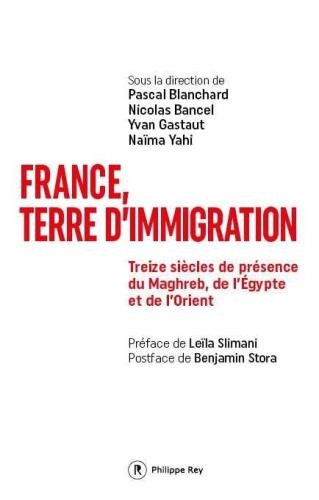En direct sur Youtube et les réseaux sociaux le 16/01/2025, 18h : conférence de Benjamin Stora autour de son dernier ouvrage L’ Algérie en guerre (1954-1962). Un historien face au torrent des images, organisée par le Groupe de Réflexion sur l’Algérie (GRAL) en partenariat avec Alternatv.
Accord franco-algérien de 1968 : qu’en est-il réellement ? Boumediene Sid Lakhdar
La tension entre la France et l’Algérie pour dénoncer des accords n’est pas nouvelle mais il y a des pics de surchauffe, il est actuellement au plus haut. En l’espèce l’accord de 1968 en est une illustration.
Ainsi, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est le plus emblématique car il avait été une conséquence directe des accords d’Evian de 1962.
Le souhait d’une dénonciation de l’accord avait toujours été le fait de la droite française qui défavorable à un système dérogatoire au droit commun jugé trop favorable pour les ressortissants algériens.
L’ extrême droite est aujourd’hui aux portes du pouvoir et donne à cette menace une forte intensité, assumée à haute voix. Le terrain n’a jamais été aussi favorable pour elle, soit la crise des OQTF, la dénonciation de la montée des flux d’immigration de sans-papiers, de surcroît pour les personnes condamnées pour des délits et crimes et, pour beaucoup, frappés d’une décision d’OQTF.
Et comme la coupe n’était pas assez pleine, voilà que s’est empiré la tension par le rapprochement de la France des positions du Maroc à propos du conflit sahraoui. Et pour ce qui est des rapprochements internationaux de l’Algérie, ils se sont multipliés pour rejoindre le nouveau projet du « Sud global ».
C’est dans cette chaudière que vient s’incruster le nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Rotailleau, qui catalyse en sa personne toute la puissance de la volonté de remise en cause de l’accord franco-algérien de 1968.
Que contient cet accord, cause de toutes les crispations ?
Les termes de l’accord de 1968
Nous l’avons dit, c’est un accord qui fait suite aux accords d’Evian en 1962 pour cette fois-ci définir les conditions de flux des personnes entre les deux pays, particulièrement pour les règles et les droits des travailleurs installés en France.
Dans son préambule, quelques phrases résument la profession de foi des signataires :
« Soucieux d’apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français ».
Puis dans un énoncé des objectifs globaux : « Conscients de la nécessité de maintenir un courant régulier de travailleurs, qui tienne compte du volume de l’immigration traditionnelle algérienne en France ;
Animés du désir :
• de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens ;
• d’améliorer leurs conditions de vie et de travail ;
• de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident déjà en France ou qui s’y rendent par le canal de l’Office national de la main d’œuvre, dans le cadre d’un contingent pluriannuel déterminé d’un commun accord ;
Convaincus de l’intérêt de garantir et d’assurer la libre circulation des ressortissants se rendant en France sans intention d’y exercer une activité professionnelle salariée ».
L’ accord est donc considéré comme dérogatoire au droit commun. Il faut à cette étape savoir que ce terme dérogatoire n’est que très peu significatif. On ne conçoit pas un accord international bilatéral sans qu’il soit considéré comme privilégié. Le sens de dérogatoire est entendu dans cet accord comme des mesures exceptionnellement larges justifiées par le nombre important des flux et des installations.
Et ce sont justement les articles qui suivent le préambule qui indiquent bien l’importance du champ dérogatoire. Comment pouvait-il en être autrement suite au lien séculaire entre les deux pays, une rupture dans la guerre et un intérêt commun à préserver des échanges et des accords privilégiés ?
Le préambule est assez court car les grands principes d’un accord avaient déjà été proclamés dans les accords d’Evian. L’accord de 1968 est en fait un catalogue de dispositions juridiques qui vont dans le détail des droits et obligations.
L’ un des articles que je prendrai en exemple est l’article 4 (l’un des deux premiers, car le 1 et le 2 ayant été supprimés) car il est l’un des points les plus sensibles pour ceux qui dénoncent farouchement l’accord. L’article 4 est celui du regroupement familial autorisé par le Président Valéry Giscard d’Estaing. Il est incontestablement celui qui cristallise le plus car le regroupement familial est considéré comme celui qui a fait exploser les chiffres de l’immigration par l’ampleur des générations suivantes.
Article 4 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille …/… ».
Suit l’énoncé des exceptions introduites par la phrase « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : …/… ».
L’ accord comprend douze articles de contenus plus ou moins détaillés suivis de quatre titres du « Protocole ». L’article 5 concerne les conditions d’établissement des non-salariés. Les articles 6, 7 et 7 bis fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence.
Et ainsi de suite.
Le statut juridique de l’accord
Cette partie nous rappelle que la dénonciation de l’accord ne pourra intervenir que par l’intervention du Parlement puisque ce qui est décidé par lui ou par referendum ne peut être défait que par lui ou un autre référendum.
L’ article 55 de la constitution nous précise : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Il faut bien se rendre compte que la décision de dénonciation ou de renégociation de l’accord de 1968 est politique et donc sous condition d’une majorité parlementaire qui les valident. Que va-t-il se passer dans le cas d’une majorité du Rassemblement National qui n’est dorénavant plus du domaine du fantasme ?
Comme la demande émane d’une partie de la classe politique française et non de l’Algérie, c’est bien évidemment du droit français (avec le rappel précédent) et international qu’il faut examiner les possibilités juridiques.
Par extension nul avenant à l’accord ne peut être légal sans l’intervention du Parlement. L’avenant étant une modification ou un rajout au texte initial, l’accord en a connu quatre depuis 1968.
C’est la preuve que tout ne peut se défaire ou renégocier aussi facilement mais qu’en adviendra-t-il si le Rassemblement National atteindrait la majorité absolue, ce qui n’est plus un fantasme, surtout avec le mode de scrutin proportionnel qui s’annonce.
Même en cas de non accession à cette majorité absolue par l’extrême droite, que se passera-t-il si la droite républicaine et le centre droit basculaient du côté de la rupture ou de la négociation dure ?
Et c’est justement la petite musique qui commence à s’entendre.
Des voix qui montent
Le premier à s’en être emparé est l’ancien Premier ministre Edouard Philippe qui préconise la remise en cause de l’accord. La proposition s’appuie sur une analyse politique et juridique d’un ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driencourt dans une note de mai 2023 pour Fondapol (Fondation pour l’innovation politique, un Think Tank aux idées libérales).
Dans la continuité de sa prise de position, l’ambassadeur est en ce moment le plus « enragé » pour dénoncer l’accord dans de nombreuses apparitions médiatiques. Sa voix est symptomatique de la montée en force du courant des opposants à la préservation des accords et même à leur renégociation.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, pourtant réputé pour sa modération, avait renchéri en déclarant « Cinquante-cinq ans après, les conditions ont changé. Je pense que ce traité, il faut le réexaminer ». Les sénateurs avaient déposé une résolution qui n’a pas encore eu de suite.
Des députés LR ont à leur tour déposé une proposition de dénonciation de l’accord. Elle avait été rejetée mais on sent bien que la question était plus que jamais mise en avant. Mais comme nous l’avons dit, que se passera-t-il s’ils en reviennent à cette position ?
La Première ministre, Élisabeth Borne, avait tranché en affirmant qu’il n’était pas question de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 mais qu’il était envisageable d’y apporter des aménagements. Aucune précision à ce jour n’a été donnée ni sur un calendrier ni sur le fond.
Dénonciation unilatérale ou renégociation, quels conditions et risques ?
Il est une évidence première que le traité du 27 décembre 1968 ainsi que tous les avenants qui suivirent ne comportent pas expressément (dans le texte) une clause de dénonciation.
L’ article 56 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités nous dit qu’en l’absence d’une telle clause un traité ne peut faire l’objet d’une dénonciation unilatérale qu’à la condition de l’intention des parties d’admettre la possibilité.
Or, nous l’avons dit, cette condition de « l’intention » n’apparait ni dans le texte ni dans les circonstances de son adoption. Au contraire, souvenons-nous de la déclaration du Préambule que nous avions déjà mentionné au début de l’article, les deux gouvernements sont « soucieux d’apporter une solution globale et DURABLE aux problèmes relatifs à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français ».
La dénonciation unilatérale de l’accord peut donc légitimer la saisine par l’Algérie de la Cour internationale de justice de La Haye. Il s’agit là d’un risque, la dénonciation unilatérale vaut-elle la peine de le tenter ?
Et puis, nous savons ce qu’est le poids des autorités de justice internationales. Lorsque les conflits sont aigus, rien ne peut en mettre une fin sinon par la guerre ou la négociation. Là se trouve une autre question, qui est en situation privilégiée dans le rapport de force ?
Un contrat est la rencontre de deux consentements nous dit le droit. Mais les consentements sont toujours pour les parties la conséquence d’une balance avantages-inconvénients. C’est aussi et surtout un pari sur l’avenir car rien n’est aussi changeant que les circonstances futures. Comment ce rapport de force va-t-il se conclure ?
Si l’Algérie a tout à y perdre parce que les termes de l’accord sont vraiment très favorables, il n’est pas certain que la France y gagne. Les raisons cachées qui avaient amené celle-ci à signer un accord sont toujours présentes, même si elles sont amoindries. Essayons de rappeler ces raisons.
Les accords de 1968 et les sous-entendus
Les accords d’Evian prévoyaient la simple présentation d’une carte d’identité pour une entrée et circulation qui bénéfice des droits internes à l’exception des droits politiques. En réalité la France n’imaginait pas un retour aussi massif des Pieds noirs et la venue de cinq cent mille immigrés pour une installation de longue durée. L’intention de maîtriser les flux la poussera même à créer un centre de rétention clandestin à Arenc sous l’excuse d’une raison sanitaire.
Entre autres litiges les deux parties seront ainsi amenées à négocier un premier accord le 10 avril 1964. Et c’est ainsi que l’accord de 1968 fut signé par la suite.
L’intention de la France est ambivalente dès le départ en voulant en même temps réguler les flux et bénéficier d’une main-d’œuvre à bon compte pour ses besoins dans la période de grande expansion économique des « trente glorieuses ». Il lui fallait donc manœuvrer entre les deux côtés de la balance.
Nous savons ce qui est advenu pour la suite de l’histoire. La droite voulant perpétuellement affirmer que les accords de 1968 et de ses avenants annulaient les dispositions de libre circulation prévues par les accords d’Evian de 1962.
On pourrait penser que cela n’a aucun sens car ce qui est applicable est le texte de 1962 et ses avenants. Il y a pourtant un point de droit qu’il faut comprendre. Si le texte de 1968 annulait celui de 1962 cela voudrait dire que la libre de circulation n’est plus le principe de base sur lesquels vont se joindre les limites. Les tentatives n’ont jamais pu avoir une concrétisation juridique et le Conseil d’Etat a reconnu que l’accord faisait expressément le lien avec les accords de 1962.
La France n’a donc aucune possibilité juridique pour légitimer la dénonciation unilatérale de l’accord pour les raisons présentées précédemment. Il ne reste que l’accord mutuel de rupture ou la négociation. Ce qui dans les deux cas suppose l’accord de l’Algérie.
Et c’est là, comme pour toute négociation d’un accord, que s’impose de nouveau l’examen de la balance avantages-inconvénients pour l’Algérie.
Il serait difficile d’affirmer que l’accord franco-algérien dérogatoire au droit commun ne soit pas favorable aux ressortissants algériens. Cela étant légitime vu le besoin d’immigration de la France et leur travail qui, malgré l’avis contraire d’une grande partie de la droite, reste nécessaire à la croissance économique du pays d’accueil. Tous les rapports à ce sujet prouvent le danger à réduire la population immigrés tant il y a une pénurie de main d’œuvre dans tous les domaines.
La réalité de la courbe démographique
L’intention de régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers « sous tension » dans la proposition de loi sur l’immigration est la preuve du besoin économique y compris pour le futur vu le déclin démographique inéluctable.
L’ Algérie a des atouts et elle ne devrait pas craindre une renégociation. Il n’y a aucun intérêt pour elle si la dénonciation unilatérale condamne la France à un lourd dédommagement. Elle ferait perdre aux ressortissants algériens l’avantage acquis de la dérogation au droit commun.
Les avantages à rejoindre le droit commun existent mais ils restent très marginaux par rapport à ce qui serait perdu.
Pour le moment, le statut quo est préférable pour tous mais la fièvre semble s’installer. Il faut envisager que ce statut quo ne sera pas solide pour tenir à moyen terme.
Source : Le Matin d’Algérie – 11/01/2025 – https://lematindalgerie.com/accord-franco-algerien-de-1968-quen-est-il-reellement/
Relations franco-algériennes : les tensions s’exacerbent – Samia Naït Iqbal
Sujettes à de récurrentes perturbations, les relations franco-algérienne ont rarement connu un niveau de dégradation que celui observé ces derniers jours, en raison de l’accumulation de tensions qui se sont exacerbées depuis la fin de l’année 2024.
Les déclarations polémiques au vitriol échangées entre les présidents des deux pays autour de l’incarcération de l’écrivain Boualem Sansal sont les signes avant-coureurs d’une montée en cadence dans l’escalade verbale d’un degré jamais égalé.
Le refus de l’Algérie d’accueillir sur son sol « l’influenceur » algérien de 59 ans expulsé de France jeudi dernier après-midi vient de donner une tournure imprévisible aux relations bilatérales entre l’Algérie et l’ex-puissance coloniale.
Au sens des autorités françaises ce refus est un acte de défiance, « d’humiliation » qui ne restera pas sans réponse, promet le ministre français de l’Intérieur, le très droitier Bernard Retailleau.
« La France ne peut pas supporter cette situation. L’Algérie cherche à humilier la France. Nous devons désormais évaluer tous les moyens à notre disposition vis-à-vis de l’Algérie pour défendre nos intérêts », dira avec fermeté le ministre français de l’Intérieur, en réaction à la fin de non-recevoir opposée par l’Algérie à l’exécution d’une disposition judiciaire qui n’est pourtant pas la première du genre entre les deux pays.
En effet, il est incompréhensible qu’un Etat qui se dit protecteur de ses citoyens refuse d’accueillir un des siens quand il est expulsé par un autre pays. En vrai, l’Algérie n’a rien trouvé de mieux pour agacer Paris que de refuser un des siens, qui sera du coup offert aux prisons françaises. Le régime, pour chatouiller l’orgueil des Algériens, sacrifie un de ses « combattants » de l’ombre pour la bonne cause en somme !
Cela d’autant plus que la décision concerne un citoyen de nationalité algérienne qui vient de faire l’objet d’une mesure administrative de déchéance de sa qualité de résidant sur le sol français et d’expulsion suite à des appels à la violence et au meurtre d’opposants algériens au régime du président Abdelmadjid Tebboune.
Le bon sens aurait voulu que cet individu soit accueilli mais non, le régime préfère le renvoyer. Ce qui a les faveurs bien entendu du concerné qui, bien que critique envers la France et défenseur zélé du régime algérien, ne veut aucunement être renvoyé en Algérie. Tout le paradoxe de ces « tiktokeurs » est là.
Il va sans dire que cette fermeté affichée par le ministre français de l’Intérieur est du pain béni pour les autorités algériennes en mal de reconnaissance interne. Elles surferont encore sur le passé pour cacher les avanies de l’actualité.
Il n’est pas exclu de voir ladite réponse de même que l’évolution inattendue que connaissent les relations entre la France et l’Algérie avoir faire l’objet d’un examen par anticipation, lors de la réunion du Conseil de sécurité de jeudi dernier. Un conclave annoncé mais dont l’ordre du jour est resté secret.
Visiblement, le conflit a atteint un point de non non-retour. Reste à savoir quelle suite connaîtra cette affaire dans le proche avenir. Les deux capitales s’en tiendront-elles aux mots ou iront-elles jusqu’à la rupture des relations diplomatiques ? Affaire à suivre.
Source : Le Matin d’Algérie – 11/01/2025 – https://lematindalgerie.com/relations-franco-algeriennes-les-tensions-sexacerbent/
La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme relocalise son action en France – Mustapha Kessous
L’organisation emblématique de la société civile algérienne, créée en 1985, a été dissoute par le pouvoir en juin 2022. En exil, des militants ont décidé de poursuivre leur combat humaniste de Paris.
Le combat des militants des droits de l’homme algériens continue. Non plus de Tizi-Ouzou, Béjaïa ou Tamanrasset, mais de Paris. Dissoute en catimini en juin 2022 par le tribunal administratif d’Alger – une décision que les responsables ont apprise sept mois plus tard –, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) a été « réactivée sous une forme juridique différente de l’étranger », ont annoncé au Monde des membres de l’organisation, aujourd’hui en exil en France.
Le 29 octobre, ces derniers ont déposé les statuts d’une nouvelle association, appelée « Collectif de sauvegarde de la ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme » (CS-LADDH), à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de continuer à dénoncer l’arbitraire en Algérie.
« Nous relocalisons la lutte en France afin de poursuivre notre mission de résistance, martèle son président, Adel Boucherguine. On ne va pas laisser tranquille le régime de notre pays. » Même lorsque celui-ci annonce des gestes d’« apaisement », comme la grâce, le 25 décembre, de 2 471 détenus par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la méfiance reste de mise. « On ne fait pas confiance à ce régime », explique M. Boucherguine.
Pour ce journaliste de 38 ans, réfugié politique dans l’Hexagone, il s’agit de continuer à documenter la répression qui vise des voix dissidentes : les militants démocrates, les partisans du Hirak, le soulèvement populaire de 2019, ou les journalistes.
La diaspora « dans son rôle historique »
« Il n’y a plus de témoin de l’arbitraire en Algérie, assure Aissa Rahmoune, directeur exécutif de l’association et désormais réfugié politique en France. Pour un like [sur les réseaux sociaux] ou un poème, on peut aller en prison. La peur est omniprésente. » Pour cet avocat, il faut être « la voix de ceux qui ne peuvent plus rien dire ». « De Paris, on peut alerter l’opinion algérienne et internationale sans rien risquer, tout en poussant les autorités à respecter les traités qu’elles ont signés », insiste-t-il.
Pour y arriver, le CS-LADDH compte s’appuyer sur le réseau de la Ligue, « devenu clandestin en Algérie ». Créée en 1985, cette dernière a été une organisation emblématique de la société civile. Elle a survécu à toutes les convulsions politiques du pays, y compris à la « décennie noire » des années 1990. Depuis le Hirak, elle est devenue la cible privilégiée des tenants de la restauration autoritaire en cours en Algérie.
Plusieurs de ses responsables, comme son vice-président Kaddour Chouicha, ont été poursuivis pour avoir participé au soulèvement pacifique et critiqué le pouvoir. D’autres membres de l’organisation ont été condamnés et sont en détention. « Même Abdelaziz Bouteflika [président algérien de 1999 à 2019] et le général Toufik, tout-puissant patron du renseignement [de 1990 à 2015], n’avaient osé dissoudre la Ligue, rappelle Adel Boucherguine, elle a toujours été tolérée. Aujourd’hui, le pays a sombré dans le tout répressif. »
Le CS-LADDH a aussi une autre ambition : rassembler les autres organisations algériennes des droits humains basées à l’étranger. « La diaspora est encore le seul élément qui échappe au régime et qui lui résiste », note Ali Ait Djoudi, président de l’association Riposte internationale.
« Elle est dans son rôle historique, pointe le militant Saïd Salhi, réfugié en Belgique et ancien vice-président de la LADDH. Lors des moments difficiles pendant la guerre d’Algérie [1954-1962], la diaspora avait pris le relais et permis au mouvement national de sortir vainqueur. Espérons que, comme par le passé, cette mobilisation fasse naître un changement durable pour l’Algérie. »
Source : Le Monde Afrique – 31/12/ 2024 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/12/31/la-ligue-algerienne-pour-la-defense-des-droits-de-l-homme-relocalise-son-action-depuis-la-france_6475277_3212.html
France, terre d’immigration – P. Blanchard, N. Bancel, Y. Gastaut et N.Yahi (dir.)
Ouvrage collectif sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Yvan Gastaut et Naïma Yahi
Préface : Leïla Slimani – Postface : Benjamin Stora
Contributeurs : Rabah Aissaoui, Elkbir Atouf, Léla Bencharif, Rachid Benzine, Fatima Besnaci-Lancou, Gilles Boëtsch, Saïd Bouamama, Hassan Boubakri, Ahmed Boubeker, François Clément, Peggy Derder, Eric Deroo, Pierre Fournié, Julien Gaertner, Piero-D. Galloro, Bernard Heyberger, Florence Jaillet, Raymond Kévorkian, Smaïn Laacher, Sandrine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Gilles Manceron, Abdallah Naaman, Christine Peltre, Belkacem Recham, Véronique Rieffel, Alain Ruscio, Ralph Schor, Stéphane de Tapia et John Tolan.
Éditions Philippe Rey, janvier 2025
Présentation de l’éditeur
Du début du VIIIe siècle jusqu’au premier quart finissant du XXIe siècle, les relations nouées par la France avec les populations issues du monde maghrébo-oriental furent parfois conflictuelles, parfois fusionnelles, mais jamais rompues, tout en restant méconnues encore aujourd’hui. Dans cet ouvrage ambitieux, plus d’une trentaine de spécialistes unissent leurs savoirs pour explorer sur le temps long la permanence de ces liens avec une aire culturelle aux frontières mouvantes à travers l’histoire, et qui s’étend sur une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, des côtes de l’Atlantique à la Turquie, de l’Afrique du Nord à l’Arménie, du Liban au Sahara, de la péninsule arabique à l’Égypte.
Ce récit est riche d’une histoire forte des liens tissés avec ces nations et leurs populations, mais aussi des mouvements migratoires entretenus avec l’Hexagone, qui se densifient à partir du XIXe siècle et se développent au siècle suivant, notamment en provenance du Maghreb, d’abord d’Algérie puis de Tunisie et du Maroc.
Génération après génération, ces nouveaux arrivants diversifient la vie politique, sportive, économique, artistique et littéraire de la société française. Ce métissage n’est pas le fruit d’une secousse ponctuelle, mais bien le résultat de treize siècles d’histoire commune, faisant de la France une terre d’immigration.
Source : http://www.philippe-rey.fr/livre-France,_terre_d_immigration-637-1-1-0-1.html
Sommaire
- Préface : Leïla Slimani
- Introduction – L’ histoire d’une présence si lointaine (Maghreb, Égypte et Orient) – Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Yvan Gastaut et Naïma Yahi
- Chapitre I – 718-1797 – Histoires croisées autour de la Méditerranée
- Chapitre II – 1798-1871 – Rêves d’Orient
- Chapitre III – 1872-1913 – Premières présences, premières rencontres
- Chapitre IV – 1914-1918 – L’appel aux colonies, l’appel aux travailleurs
- Chapitre V – 1919-1939 – Réfugiés, ouvriers, militants
- Chapitre VI – 1940-1956 – D’une guerre à l’autre
- Chapitre VII – 1957-1972 – Des indépendances à la fin des Trente Glorieuses
- Chapitre VIII – 1973-1982 – Le temps des revendications
- Chapitre IX – 1983-2000 – Nouvelles générations
- Chapitre X – 2001-2013 – Crispations et cultures partagées
- Chapitre XI – 2014-2024 – L’ ère de l’omniprésence, entre ombre et lumière
- Postface : Benjamin Stora – Au carrefour de nos histoires
- Bibliographie
- Biographies
En Algérie, la fuite des cerveaux s’accélère – A. Boumezrag
Comme d’autres pays du Maghreb, l’Algérie subit une hémorragie continue de ses élites diplômées vers les pays occidentaux. Un phénomène dont les racines plongent dans un avenir bouché, des pesanteurs sociales et un état des libertés en peau de chagrin, analyse “Le Matin d’Algérie”. L’urgence est donc de refonder le pacte social et de miser sur les forces et compétences des diasporas algériennes.
L’ Algérie a longtemps été perçue comme un pays aux richesses naturelles inépuisables. Le pétrole et le gaz continuent de dominer les discours officiels, les stratégies économiques et les échanges internationaux.
Pourtant, un autre type d’exportation, moins visible mais ô combien stratégique, prend de l’ampleur : celle des cerveaux. Médecins, ingénieurs, artistes, intellectuels… Ils forment ce nouveau “gazoduc” invisible, qui alimente l’Europe en savoir-faire et en talents, tandis que le pays d’origine voit son capital humain se dissiper, comme un gaz précieux qui s‘échappe sans retour.
L’avenir est ailleurs
L’expression “exportations hors hydrocarbures” fait sourire amèrement les Algériens. Officiellement, elle désigne des produits manufacturés ou agricoles. Officieusement, elle symbolise l’exode massif de la jeunesse diplômée.
Des milliers de médecins formés dans les facultés algériennes opèrent aujourd’hui dans les hôpitaux européens. Des ingénieurs, aux compétences aiguisées dans des universités locales, conçoivent des projets innovants loin de leur terre natale. Des artistes, en quête de reconnaissance et de liberté, font vibrer des scènes étrangères.
Le paradoxe est cruel : le pays investit dans la formation de ces talents, mais c’est ailleurs qu’ils déploient leur potentiel. En retour, l’Algérie ne récolte ni royalties ni dividendes, seulement une hémorragie sociale et intellectuelle. La fuite des cerveaux n’est pas un phénomène nouveau, mais elle s’accélère. Manque de perspectives, climat économique incertain, libertés restreintes, reconnaissance professionnelle limitée…
Contrairement aux hydrocarbures, les talents humains sont une ressource infiniment précieuse et non renouvelable. Chaque médecin qui quitte l’Algérie, c’est un investissement national qui s’évapore. Chaque ingénieur qui part, c’est un projet avorté pour le pays. Chaque artiste exilé, c’est un fragment de culture qui s’éloigne. Le vide laissé est immense, difficile à combler, car les générations futures voient, elles aussi, leur avenir ailleurs.
L’urgence de miser sur les diasporas
Le véritable défi pour l’Algérie n’est pas seulement économique, mais aussi social. Comment retenir ses élites ? Comment transformer cette fuite en force ? Les diasporas sont souvent perçues comme des ressources à distance. Encore faut-il créer les conditions pour qu’elles puissent contribuer au développement national, même de loin. Mais le plus urgent reste de redonner confiance à ceux qui sont encore là, à cette jeunesse qui hésite entre partir ou rester, entre rêver ici ou réussir ailleurs.
L’ Algérie ne manque pas de richesses ; elle manque de vision. Le gaz naturel rapporte des devises, mais les esprits, eux, rapportent un avenir. Ce “gazoduc humain” vers l’Europe pourrait devenir un véritable levier de transformation si le pays décidait enfin d’investir dans ses citoyens avec la même énergie qu’il investit dans ses ressources naturelles.
L’ Algérie se trouve à un tournant décisif. Le pays dispose d’une richesse humaine considérable, mais cette ressource ne pourra jouer pleinement son rôle que si elle est reconnue, valorisée et, surtout, retenue. Le défi n’est pas uniquement de limiter les départs, mais de créer un écosystème où les talents peuvent prospérer. La solution n’est pas de fermer les frontières aux rêves de réussite ailleurs, mais de les ouvrir à la possibilité de réussir ici.
Les investissements dans l’éducation et la formation ne doivent pas être vus comme des coûts, mais comme des paris sur l’avenir. Il est temps de comprendre que la véritable richesse d’un pays ne se mesure pas à ses réserves de pétrole, mais à sa capacité à inspirer et à retenir ses citoyens.
Paradoxalement, la diaspora algérienne, puissante, riche et intelligente, pourrait jouer un rôle clé dans la reconstruction nationale. De nombreux talents exilés ne demandent qu’à contribuer au développement de leur pays d’origine. Mais pour cela, il faut dépasser les symboles et les discours patriotiques. Il est nécessaire de mettre en place des politiques concrètes de réintégration, d’échanges et de coopération avec ceux qui ont choisi de partir. Leur expérience internationale, leur réseau et leur expertise peuvent devenir un moteur puissant pour l’économie et la société algériennes. Encore faut-il leur donner une raison de croire en un retour, même virtuel.
Ce malaise algérien profond
Les tensions sociales, la fuite des cerveaux et l’exode des talents ne sont pas des fatalités. Ce sont les symptômes d’un malaise plus profond. Pour y remédier, des réformes courageuses et structurelles sont indispensables : moderniser l’économie, renforcer l’état de droit, valoriser le mérite, encourager l’innovation et offrir des perspectives concrètes à la jeunesse. Il ne s’agit pas seulement de retenir des compétences, mais de créer un environnement où elles peuvent s’épanouir.
Imaginez un scénario différent : un “gazoduc” humain où les flux s’inversent. Où les médecins, ingénieurs, artistes et intellectuels, loin de partir définitivement, choisiraient de revenir, ne serait-ce que pour des projets temporaires. Où la réussite à l’étranger ne serait pas une fuite, mais une étape avant un retour enrichissant. Où l’Algérie deviendrait un pôle d’attraction pour ses talents, et même pour ceux venus d’ailleurs.
Mais pour cela, il faut cesser de voir ses citoyens comme des ressources exploitables et commencer à les considérer comme les véritables architectes de l’avenir.
Car, au final, le plus grand défi de l’Algérie n’est pas de remplir ses pipelines de gaz, mais de remplir les esprits de rêves réalisables. C’est là, et seulement là, que réside la véritable souveraineté nationale.
L’ Algérie est à la croisée des chemins, où le choix entre exploiter les talents et les laisser s’échapper devient crucial. Investir dans l’humain, c’est assurer la durabilité d’une économie aujourd’hui trop dépendante des hydrocarbures. La richesse d’une nation se mesure à son capital humain : une jeunesse bien formée, un tissu entrepreneurial dynamique, et des institutions qui font naître l’émergence de leaders capables de transformer le pays.
Imaginons une Algérie…
Les exemples de nations qui ont réussi à se réinventer ne manquent pas. Prenons l’exemple de la Corée du Sud, autrefois dévastée par la guerre, aujourd’hui géant technologique et culturel. Son secret ? Un investissement massif dans l’éducation et l’innovation, et une valorisation sans compromis de ses talents nationaux. L’Algérie, avec sa jeunesse dynamique et ses ressources naturelles, possède tous les ingrédients pour réussir une transition similaire. Mais cela nécessite une vision claire et, surtout, une volonté politique de passer de la parole aux actes.
Aujourd’hui, les meilleurs cerveaux partent faute de perspectives. Mais imaginons une Algérie où les médecins ne s’exilent plus en France pour échapper à des conditions de travail précaires, où les ingénieurs ne cherchent plus refuge dans la Silicon Valley faute de reconnaissance, où les artistes ne s’exilent plus en Europe pour pouvoir créer librement.
Le retour des compétences algériennes ne doit pas seulement être souhaité, il doit être activement encouragé. Faciliter les démarches administratives pour les entrepreneurs de la diaspora, valoriser les diplômes obtenus à l’étranger, créer des partenariats avec les universités internationales : autant de mesures concrètes qui pourraient transformer la fuite des cerveaux en un véritable réseau mondial au service du développement national.
La crise actuelle n’est pas seulement économique, elle est aussi sociale. Les jeunes Algériens ont besoin de perspectives, pas de discours. Ils veulent un pays où le mérite l’emporte sur les passe-droits, où l’avenir n’est pas conditionné par la naissance ou les relations, mais par le talent et l’effort. Ce nouveau pacte social doit être fondé sur la justice, l’équité et l’égalité des chances. C’est la condition sine qua non pour retenir les talents et redonner confiance à une jeunesse désabusée.
Source : Courrier international – 09/12/2024 https://www.courrierinternational.com/article/economie-en-algerie-la-fuite-des-cerveaux-s-accelere_225028
Appel à manifester – Le général Bigeard à Toul – 11/01/2025
Samedi 11 janvier 2025 à 14h00 – Gare de Toul
Le Collectif « Histoire et mémoire dans le respect des droits humains », qui s’oppose, depuis le 24 octobre 2024, à l’installation par la mairie de Toul d’une statue du général Bigeard dans l’espace public, appelle à un rassemblement, pour rappeler le parcours historique de celui-ci, notamment lors de la guerre d’Algérie. « Nous refusons que la mairie de Toul participe à la nostalgie du temps des colonies, la Nostalgérie… » précise ce Collectif.
Une tribune avait par ailleurs été publiée dans le journal Le Monde, le 31 octobre 2024, au sujet de cette édification à Toul : « Torture en Algérie : Sans un retour sur cette page sombre de son histoire, rien ne préserve la République de retomber dans les mêmes dérives… »
Dans cette ville de Meurthe-et-Moselle, la figure du général Bigeard (1916-2010) est controversée. La mairie et le maire, qui se présentent comme étant « de gauche », ont acté cette installation à deux reprises en conseil municipal, acceptant le « don de l’œuvre » par la Fondation Marcel Bigeard, qui nourrit ce projet depuis plusieurs années pour l’imposer dans cette ville.
Le général Bigeard est déjà, rappelons-le, très présent dans l’espace public. À Carcassonne, une stèle a été inaugurée en juin 2012. Des rues, des places et une avenue existent aux quatre coins de la France : à Aix-en-Provence, à Aix-les-Bains, à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), à Briey, à Tellancourt et à Lexy (Meurthe-et-Moselle), à Dreux, à Lagord (Charente-Maritime), au Tampon sur l’île de La Réunion, à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), à Scionzier (Haute-Savoie), à Trimbach (Bas-Rhin), à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)…
Pétition : https://www.change.org/p/pas-de-statue-de-marcel-bigeard-dans-l-espace-public
Source : 4ACG https://www.4acg.org/Statue-de-Bigeard-Un-appel-du-collectif-Histoire-et-Memoire-dans-le-Respect-des