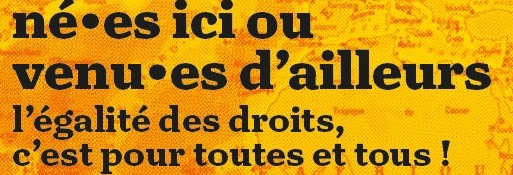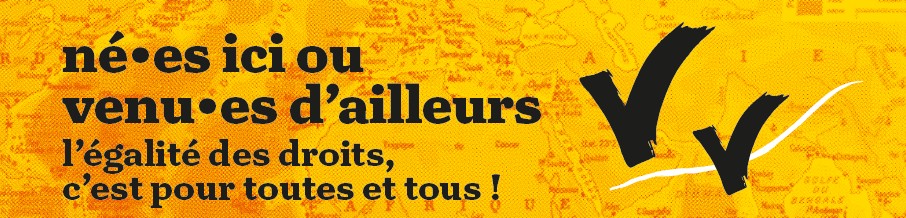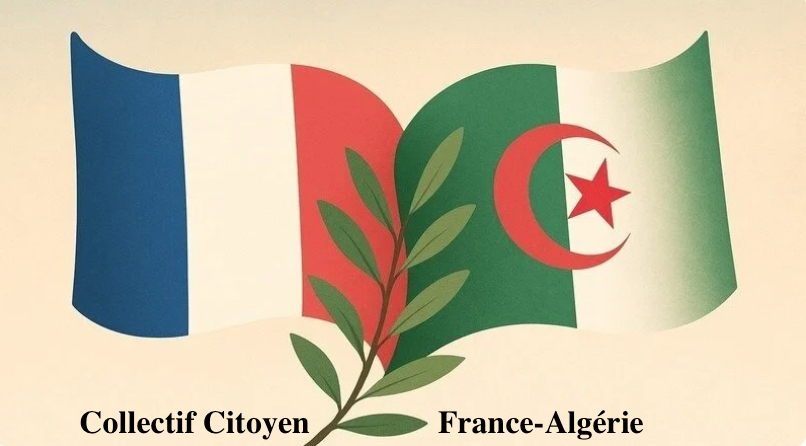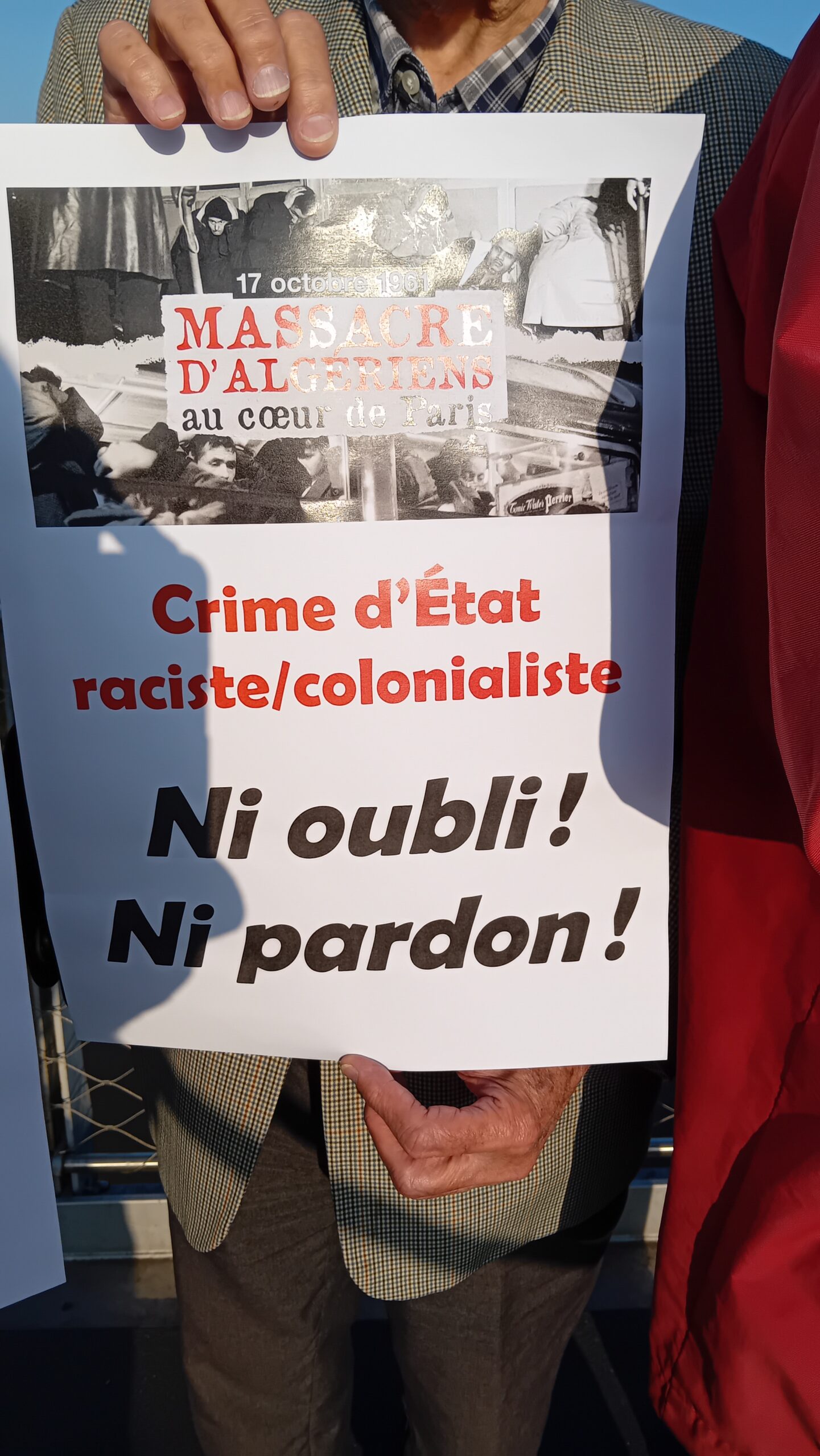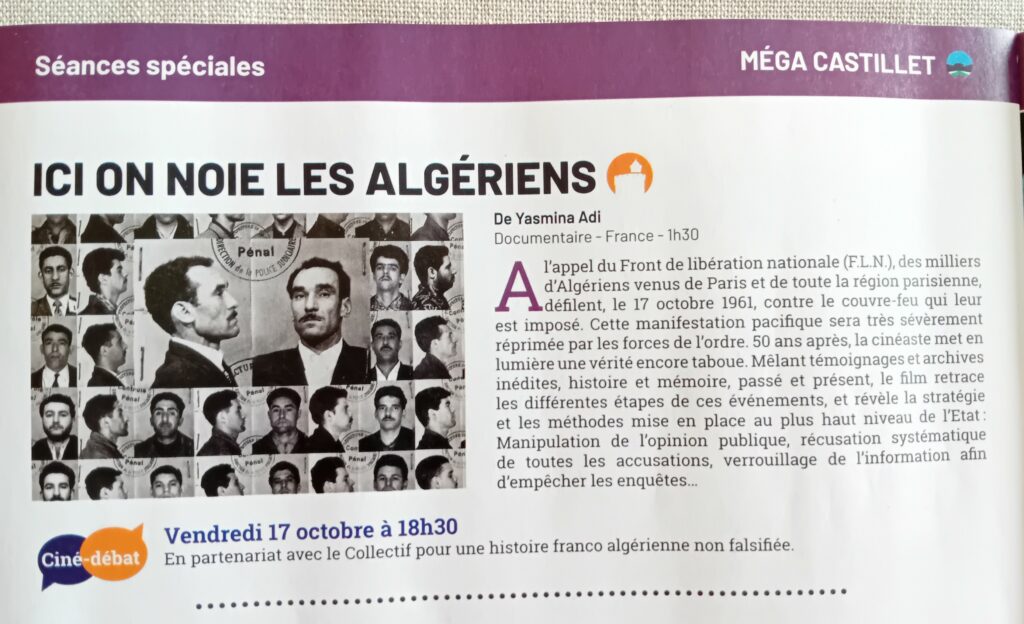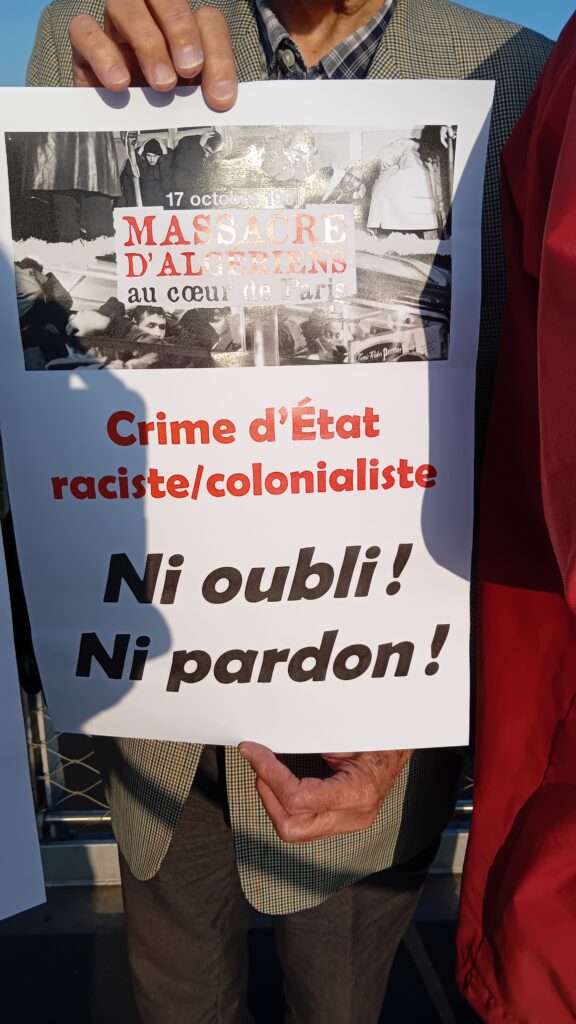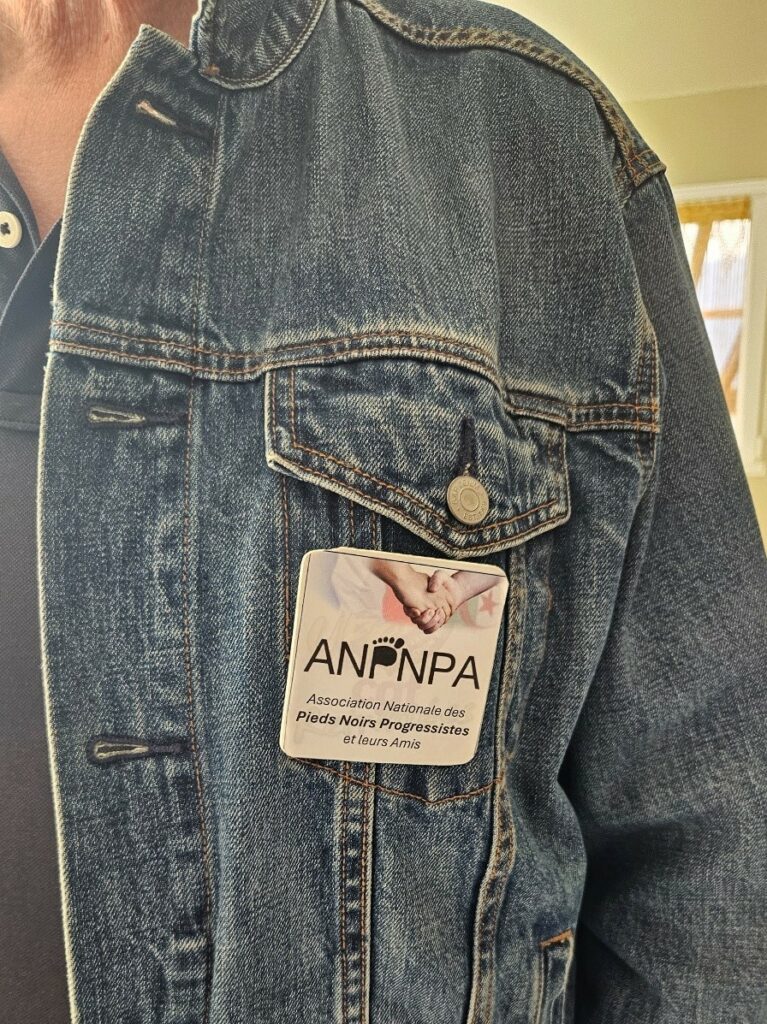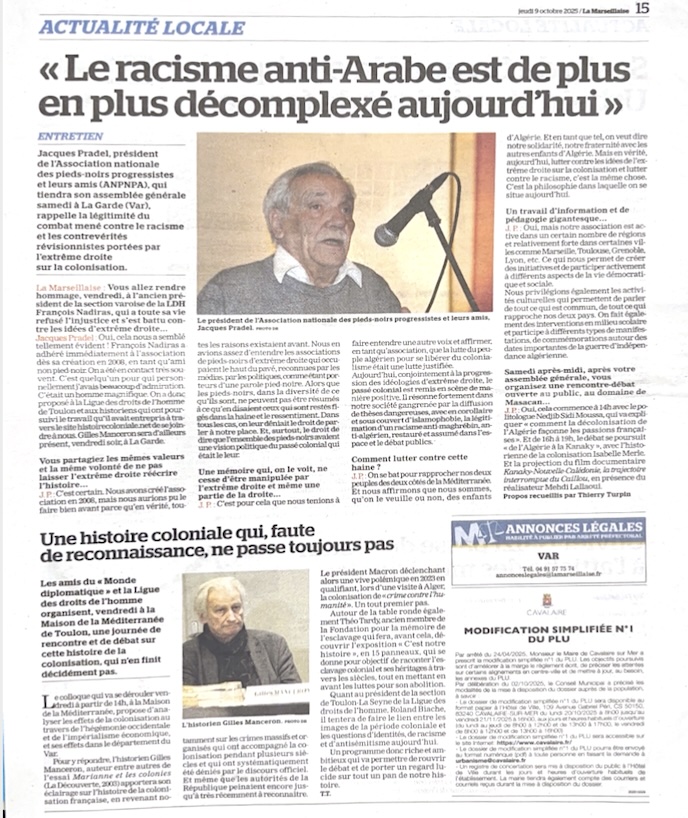Appel collectif à mobilisation dans le cadre de la Journée internationale des migrant-es, le 18 décembre 2025, à Paris (18h, place de la République) et partout en France
Né-es ici ou venu-es d’ailleurs : pour une France de liberté, d’égalité et de solidarité
Restrictions drastiques des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile, refus de régularisation, refus de premier titre de séjour, refus de renouvellement de titre de séjour, remise en cause des APL pour les étudiant-es étranger-es, obligations de quitter le territoire français (OQTF) systématiques et généralisées, placements en rétention, cette politique migratoire, véritable fabrique de sans-papiers, attentatoire aux droits et à la dignité des personnes étrangères doit cesser.
La loi immigration du 26 janvier 2024 et la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, ont des conséquences humaines catastrophiques pour les personnes étrangères qui souhaitent travailler, étudier, se soigner, se marier, avoir une vie familiale en France. Tout est organisé pour leur rendre la vie impossible, en les soumettant quotidiennement à une violence sociale, administrative et institutionnelle incompatible avec la promesse démocratique de nos sociétés.
Les régularisations permettant d’obtenir un titre de séjour par le travail ou en raison de la vie privée et familiale, ont été réduites à un niveau tel qu’elles sont en pratique inaccessibles. Des dizaines de milliers de personnes étrangères, confrontées au blocage des préfectures et à la lenteur du renouvellement de leurs titres, se retrouvent dans des situations dramatiques, rupture de contrats de travail, de droits sociaux, perte de logement, sous prétexte de dématérialisation, mais en réalité en raison d’une politique discriminatoire et xénophobe.
Le nombre d’OQTF a encore augmenté, générant angoisses, stigmatisation, pertes de droits, basculement dans la précarité. La France détient le record du nombre d’OQTF prononcées en Europe, soit 120 000 à 130 000 OQTF en 2024, soit un quart des OQTF délivrées par les 27 états membres de l’Union Européenne. Or, la plupart de ces OQTF sont inexécutables. Celles mises en œuvre brisent des vies, des liens familiaux, renvoient des exilé·es vers des enfers qu’elles et ils ont fuis. Il s’agit, de fait, d’un outil de pression et de répression visant à mettre les personnes exilé·es dans une situation de profonde vulnérabilité administrative, sociale et économique, et de leur signifier qu’elles seraient indésirables en France.
Cette politique fait le jeu de l’extrême droite, alimente le racisme et la surexploitation des travailleuses et des travailleurs migrant-es, avec ou sans papiers, faisant du traitement inégalitaire et stigmatisant des personnes étrangères la norme. Tout ceci permet aux médias détenus notamment par le groupe Bolloré de déverser chaque jour leur haine et leurs affirmations mensongères suscitant la peur et la division, pour se placer en protecteurs contre des dangers fictifs.
Ce n’est pas la France que nous souhaitons !
Nous souhaitons une France de liberté et d’égalité ! Les droits à l’éducation, aux protections sociales, à la santé, au travail, au logement, aux loisirs, à la culture… doivent être les mêmes pour toutes et tous afin de permettre à chacune et chacun de construire librement son quotidien et son avenir.
Nous souhaitons une France accueillante, inclusive et solidaire ! Les personnes étrangères ne sont ni une menace ni une variable d’ajustement économique et électoraliste mais une richesse pour notre société. La diversité qu’ils et elles incarnent et leur contribution à la vie collective sont des atouts précieux.
Nous souhaitons que les personnes étrangères vivant en France, qui y ont des attaches familiales ou privées, y travaillent, étudient, puissent avoir accès à un titre de séjour stable et protecteur, pour contribuer, en toute légalité et en toute égalité, à la vie culturelle, sociale et économique de notre pays.
Les organisations du collectif né-es ici ou venu-es d’ailleurs appellent à une large mobilisation de la société civile, dans toute sa diversité, pour dénoncer cette nouvelle vague d’attaques extrêmement graves envers les personnes étrangères en France et pour défendre un autre projet de société, humaniste, solidaire et égalitaire.
Premiers signataires : Attac, CGT, La Cimade, Femmes Egalité, FSU, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Oxfam France, Mrap, Union syndicale Solidaires, SOS Racisme, Unef.
Autres signataires : Accueil Réfugiés Bruz (35), Accueil Solidaire Grenoble, Action catholique ouvrière (ACO), Aides, Amnesty International France, Les Amoureux au ban public, Arcolan Pau Béarn, L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L’Acort), Association Douba, Association des familles victimes du saturnisme (AFVS), Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafe), Association des Marocains en France (AMF), Association d’accueil des demandeurs d’asile Mulhouse (AADA – Mulhouse), Association nationale des pieds-noirs progressistes et leurs ami.e.s (ANPNPA), Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita), Association Solidarité mamans (papas) solos, Association Unjourlapaix à Embrun, ATD Quart Monde, ATPAC Maison Solidaire, La Boutique d’écriture, CSBE La Place Santé, Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (Cetedim), Centre de recherche et d’information pour le développement (Crid), CFDT Moselle, Collectif Accès au droit, Collectif accueil migrants Barbezieux, Collectif Chabatz d’entrar Limoges, Collectif Migrants 83, Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Collectif saint-lois d’aide aux migrants (CSLAM), Comede (Comité pour la santé des exilé.e.s), Comité Nîmois des Soulèvements de la Terre, Comité de suivi du symposium sur les Sénégalais de l’extérieur (CSSSE), CRDE – Solidarité Migrants Pau Béarn (Collectif pour le respect des droits des étrangers), La Croisée des chemins, Cuisine sans frontières, Diaconat protestant de Grenoble, Dom’Asile, Une Ecole, un Toit, des Papiers – Pays dacquois (ETP-Pays dacquois ), Elena-France, Emmaüs France, Fédération des associations générales étudiantEs (Fage), Fédération Etorkinekin Diakité, Femmes de la Terre, Femmes Solidaires 93, France Amérique Latine (FAL), Groupe accueil et solidarité (Gas), Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré·es), Grève Féministe, J’en suis j’y reste – centre LGBTQIAF de Lille (JSRS), Ligue de l’Enseignement de l’Isère, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie (LFID), Madera, Maison de l’hospitalité Martigues, Médecins du Monde, Min’de Rien, Mouvement français pour le Planning familial, Mouvement de la Paix, #NousToutes, Observatoire des camps de réfugiés, Organisation de Solidarité Trans (OST) Pau Béarn, People’s Health Movement France (PHM France), Peuple et Culture (PEC), Polaris 14, Port d’attache Granville, La Pourtère, Les P’tits Papiers, RCI- Solidarité exilés, Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes (Raar), Réseau éducation sans frontières (RESF), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Louis Guilloux, Roya citoyenne, Solidarité-exil, Solidarité migrants Annecy, Rosmerta, SOS Refoulement Dijon, Sous le même ciel, Soutien Asile Nord 21, Soutien Migrants Redon, Sud Culture BNF, Sud OFII, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat de la Médecine Générale (SMG), Toutes et tous migrants, Toutes Pour Une, Transmettre un horizon à tous (Thot), Union générale des Egyptiens de France, UniR Universités & Réfugié.e.s, Urgence Palestine Pau, Utopia 56, Watizat (Paris).
Source : LDH https://www.ldh-france.org/ne-es-ici-ou-venu-es-dailleurs-pour-une-france-de-liberte-degalite-et-solidarite/