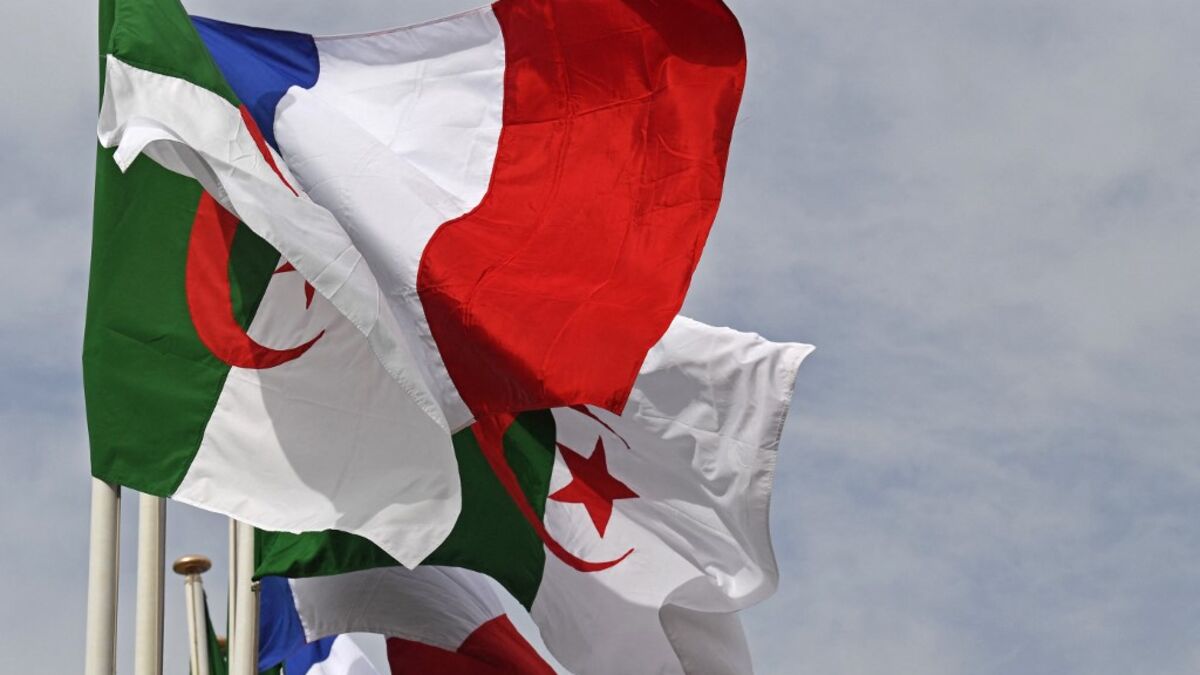Le ministre de l’intérieur pousse l’Élysée à prendre des mesures de rétorsion contre l’Algérie, qu’il sait populaires dans l’électorat de droite. Au sommet de l’État, plusieurs voix alertent sur le danger d’une rupture avec Alger et tentent de maintenir le contact. Tiraillé, Emmanuel Macron doit trancher.
Entre Paris et Alger, la météo diplomatique oscille depuis soixante ans entre épisodes tumultueux, rares éclaircies et longues périodes de froid. Chez celles et ceux que le dossier intéresse, un doute émerge toutefois ces jours-ci : assiste-t-on à une crise plus intense et plus profonde que celles qui ont émaillé les vingt dernières années ?
Dans la salle des fêtes de l’Élysée, lundi 6 janvier, plusieurs diplomates ont été surpris des mots choisis par Emmanuel Macron pour dénoncer la détention de l’écrivain Boualem Sansal. « L’Algérie entre dans une histoire qui la déshonore », a accusé le président de la République, avec une virulence inhabituelle. « Une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne », a rétorqué la diplomatie algérienne dans un communiqué.
En parallèle, un autre dossier empoisonne les relations bilatérales : l’interpellation en France de plusieurs influenceurs algériens, accusés d’incitation à la violence contre des opposants au régime. Le cas de l’un d’eux, « Doualemn », expulsé sur décision gouvernementale puis renvoyé par Alger le 9 janvier, a suscité l’ire du ministre de l’intérieur. « L’Algérie cherche à humilier la France, a dénoncé Bruno Retailleau. Je pense qu’on a atteint avec l’Algérie un seuil extrêmement inquiétant. »
Dans les réseaux diplomatiques, le durcissement du ton entre Paris et Alger était attendu depuis qu’Emmanuel Macron a rompu, fin juillet 2024, avec la position historique de la France sur le Sahara occidental. Désireux de renouer avec le Maroc, le chef de l’État a cédé à la revendication pressante du royaume, à savoir la reconnaissance de la « souveraineté marocaine » sur ce territoire considéré comme « à décoloniser » par les Nations unies.
À l’époque, Alger avait rappelé sans tarder son ambassadeur pour signifier sa mauvaise humeur. Et puis plus rien. Alors que le Quai d’Orsay anticipait d’éventuelles mesures de rétorsion, le régime n’a pas bougé, continuant même d’assurer un minimum de coopération sécuritaire et migratoire. Début septembre, l’Élysée note avec satisfaction qu’Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, accepte de recevoir Anne-Claire Legendre, la conseillère Maghreb d’Emmanuel Macron, et fasse publiquement état de leur entretien.
Et si Alger, lassé d’un conflit sahraoui vieux de cinquante ans, avait renoncé à en faire un casus belli ? L’espoir au sommet de l’État a fait long feu et la crise est bien là. Bruno Retailleau aimerait même que la France aille plus loin. « Il faut examiner l’ensemble des moyens de rétorsion qui sont à notre disposition », insiste-t-il, appelant le gouvernement et le président de la République à « ne rien s’interdire ».
Une vieille marotte de Retailleau
Dans le viseur de Bruno Retailleau : l’accord franco-algérien de 1968, initialement destiné à réguler la libre circulation des Algérien·nes en France. Révisé à trois reprises depuis, c’est une cible régulière de la droite française, qui estime comme lui que « plus rien ne le justifie ». Édouard Philippe a soutenu sa dénonciation, également réclamée depuis quelques jours par Gabriel Attal.
Parmi les autres mesures imaginées par le ministre de l’intérieur : la réduction du nombre de visas, l’augmentation des tarifs douaniers ou des coupes drastiques dans l’aide au développement. « La France ne peut pas supporter cette situation », martèle Bruno Retailleau. Pour ce dernier, l’enjeu est avant tout politique. Ce rapport de force avec l’Algérie, il l’a théorisé bien avant d’être nommé Place Beauvau.
En novembre 2022 sur LCI, alors candidat à la présidence du parti Les Républicains (LR), l’élu de Vendée est interrogé sur la façon la plus efficace de convaincre les pays d’origine d’accepter le retour de leurs ressortissant·es. Sa réponse fuse : « On assume un bras de fer, tout simplement. Avec comme monnaie d’échange les visas et l’aide au développement. »
Voilà des années que Bruno Retailleau critique les « lâchetés » et les « reculs » de la droite quand elle a été au pouvoir ; des années qu’il se forge une image de « faiseux » qui agit sans écouter la « bien-pensance de gauche » ; des années qu’il dit pis que pendre d’Emmanuel Macron, qui « ne veut pas mettre fin au laisser-aller migratoire ».
L’ancien sénateur, qui n’exclut pas de se présenter en 2027, sait aussi que le temps vaut cher dans un gouvernement minoritaire menacé de censure. Alors il fonce, pour gagner ses galons d’homme de droite courageux et pour rapatrier vers lui demain l’ancien électorat de François Fillon parti à l’extrême droite.
Dans son camp, la dénonciation du régime algérien est une cause qui fédère. Aussi témoigne-t-il régulièrement avec vigueur de la « repentance perpétuelle » et de « l’obsession mémorielle » dont se rendrait coupable Emmanuel Macron. Même les commémorations officielles du 19 mars, en hommage aux victimes civiles de la guerre d’Algérie, ne trouvent pas grâce à ses yeux. « C’est une date qui repose sur une contre-vérité, qui porte une injustice et qui divise », écrivait-il dès 2012.
« On subit l’agenda politique de la droite et de l’extrême droite, qui ont fait de l’Algérie un bouc émissaire pour des raisons électorales, déplore la députée écologiste Sabrina Sebaihi. Il y a, dans l’histoire de cette famille politique, une forme de nostalgie de l’Algérie française, qui a imprégné le logiciel idéologique. »
Président du groupe d’amitié France-Algérie, le sénateur socialiste Rachid Temal regrette « l’hystérie collective » qui s’empare de « certains ». « C’est comme si un bouchon venait de sauter, juge-t-il. C’est le moment où les hommes et les femmes de sagesse doivent dire : “On redescend tous.” » Pas le genre de Retailleau, pointe le député écologiste Pouria Amirshahi : « Il veut faire la démonstration qu’il est le chef de la droite identitaire, donc il pousse le plus loin possible l’urticant algérien dans l’opinion. »
Vu d’Alger, des menaces sans effet
Si elle n’a rien de surprenante, la stratégie guerrière de Bruno Retailleau risque de se fracasser sur le mur de la réalité. Son collègue Gérald Darmanin peut en témoigner, lui qui a déjà tenté au même poste de se servir du levier des visas pour contraindre les pays du Maghreb à accorder plus de laissez-passer consulaires. « Nous l’avons fait avec un succès très relatif, a reconnu l’actuel ministre de la justice sur LCI dimanche. Vous vous fâchez diplomatiquement et ce n’est pas efficace. »
De même, la dénonciation de l’accord de 1968 est certes symbolique pour la droite française, mais inopérante. Révisé donc à trois reprises, il ne présente plus que quelques dispositions avantageuses pour les ressortissant·es algérien·nes. « C’est une coquille vide, a déclaré en octobre Abdelmadjid Tebboune. Cet accord est devenu un slogan politique pour réunir les extrémistes. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. »
Au Quai d’Orsay, on n’est pas loin de partager cette position. « L’accord de 68 n’est vraiment pas un sujet et c’est pour ça que le président de la République n’y a pas touché », glisse une source diplomatique. La chercheuse Khadija Mohsen-Finan, spécialiste du Maghreb et des relations internationales, résume : « Les deux pays cherchent à se faire mal et ils ne savent pas par quel outil. Côté français, on puise dans le réservoir habituel, à savoir les visas et les accords de 1968. Ce sont de vieilles méthodes qui ont déjà échoué. »
Une liste à laquelle on pourrait ajouter l’aide française au développement, devenue l’argument en vogue de l’extrême droite. Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, a même fait l’objet d’une plainte de l’État algérien après avoir martelé le chiffre de 800 millions d’euros accordés par la France. En réalité, il s’agit de 130 millions d’euros par an, une somme qui finance notamment les ONG françaises sur place et des activités de conseil et de formation à certaines administrations. « Ce n’est vraiment pas de nature à faire plier le gouvernement algérien », souffle une source diplomatique.
Président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) franco-algérienne, Michel Bisac regarde avec effarement « l’hystérisation du moment ». « Vous allez couper une aide de 130 millions d’euros à un pays qui a 73 milliards d’euros de réserves de change ? Et c’est la France, avec ses 3 300 milliards d’euros de dette, qui dit ça ? C’est une blague. Au prix où se vendent le pétrole et le gaz, l’Algérie a tous ses indicateurs au vert. Ce n’est pas en les menaçant qu’on réglera la situation. Il n’y a pas d’autre choix que de se parler. »
Désescalade discrète
Si le ton belliqueux du ministre de l’intérieur répond à une logique politique, voir l’exécutif s’en accommoder surprend. Au ministère des affaires étrangères, l’activisme de Bruno Retailleau agace, comme nous le confirment plusieurs sources. « C’est une diplomatie de posture qui ne changera rien et qui peut s’avérer désastreuse pour la suite », pointe l’ancien diplomate Yves Aubin de la Messuzière, qui a dirigé au début des années 2000 le département Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d’Orsay.
« J’ai assisté à des rendez-vous tendus entre Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika à l’époque, raconte-t-il. J’ai connu des accrocs entre la France et l’Algérie. Mais tout ça se règle diplomatiquement, surtout avec l’Algérie, surtout quand on est l’ancienne puissance coloniale. Chirac tenait parfois des propos difficiles à l’égard de Bouteflika. Mais il faisait en sorte que cela ne se retrouve jamais sur la place publique. Et c’est comme ça qu’il a pu apaiser la relation franco-algérienne. »
L’omniprésence de Bruno Retailleau tient aussi au moment politique. Le premier ministre n’a pas encore finalisé son cabinet et n’a pas demandé à ses ministres de lui faire valider leurs sorties médiatiques, comme c’est l’usage. À l’Élysée, le conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a annoncé sa démission le 10 janvier, mais le président de la République souhaite le convaincre de rester.
Des facteurs auxquels il faut ajouter la surface politique d’un Bruno Retailleau conscient d’être indispensable à François Bayrou, soutenu par la droite, l’extrême droite et le chef de l’État. Face à un ministre des affaires étrangères plutôt apprécié des diplomates mais peu connu du grand public, le locataire de la Place Beauvau prend volontiers de l’espace et du temps de parole médiatique.
Face à l’enlisement de la crise et à la fronde de ses services, Jean-Noël Barrot a toutefois pris la parole mardi, dans un entretien à Brut. « C’est au Quai d’Orsay et sous l’autorité du président de la République que se forge la politique étrangère de la France », a-t-il souligné à deux reprises.
En coulisses, le Quai et la cellule diplomatique de l’Élysée tentent de reprendre la main. Malgré la virulence des propos publics, des contacts continuent d’exister entre les deux capitales, et la coopération sécuritaire, jugée indispensable à Paris, n’est pas totalement rompue. Le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), Nicolas Lerner, s’est rendu lundi à Alger avec une délégation de hauts fonctionnaires, comme l’a révélé Le Figaro.
« Il faut que nous sortions de la crise désormais et que nous puissions aller de l’avant », a affirmé Jean-Noël Barrot mardi, après s’être dit prêt à se rendre sur place. Pour Paris, une rupture avec Alger ne serait pas une bonne nouvelle, font savoir les ministères des armées et de l’économie, conscients des intérêts français en Algérie. Au ministère de la santé, on sait que les médecins algériens représentent le contingent extra-européen le plus nombreux en France.
À la tête de la CCI, avec ses 2 800 entreprises, Michel Bisac craint les « répercussions » d’une telle crise. « On a longtemps reproché au gouvernement algérien de se servir de la diplomatie pour faire diversion sur la scène intérieure, souligne-t-il. Est-ce qu’on n’est pas en train de faire la même chose ? Il y a des milliers d’entreprises françaises qui travaillent en Algérie qu’on met en danger avec des propos pareils. Chaque année, ce sont 12 ou 13 milliards d’euros d’échanges commerciaux. Et on va jeter ça pour de la petite politique ? »
Les plus optimistes dans les services de l’État voient d’un bon œil le communiqué du ministère des affaires étrangères algérien, qui assure n’être « d’aucune façon engagé dans une logique d’escalade, de surenchère ou d’humiliation ». Dans ce texte publié le 11 janvier, l’exécutif algérien semble distinguer Bruno Retailleau du Quai et de l’Élysée. « L’extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses hérauts patentés au sein du gouvernement français mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification, contre l’Algérie », dénonce le ministère.
L’énigme présidentielle
C’est désormais vers Emmanuel Macron que les regards se tournent. Une réunion est prévue dans les prochains jours à l’Élysée pour trouver une ligne commune en présence des ministres concernés, comme l’a révélé Jean-Noël Barrot mardi. « Un épisode comme celui-là, on en sort comme on est sorti de celui avec le Maroc : avec un geste et un arbitrage du président de la République, indique la chercheuse Khadija Mohsen-Finan. Pour l’instant, il est resté en retrait. C’est le seul qui peut se positionner en surplomb et faire un pas pour avancer. »
Mais en a-t-il seulement envie ? Les sorties de Bruno Retailleau n’ont pas ulcéré le président de la République, dont le cabinet avait d’ailleurs été prévenu par celui du ministre de l’intérieur. Préoccupé par l’état de santé de Boualem Sansal, le chef de l’État a nourri aussi une déception personnelle à l’égard d’Abdelmadjid Tebboune, à qui il reproche en privé de n’avoir pas tout fait pour « bousculer » un système qu’il jugeait en 2021 « construit sur une rente mémorielle ».
Tenu en privé mais révélé par Le Monde et jamais démenti, le propos avait suscité une crise diplomatique, déjà, et le retrait de l’ambassadeur algérien en France. À l’époque, Macron avait donné à Alger des gages mémoriels de sa bonne volonté. Certains dans son entourage le pressent de poursuivre ce travail, alors que l’Algérie demande toujours le nettoyage des sites des essais nucléaires menés par la France et la restitution d’objets ayant appartenu à l’émir Abdelkader, figure emblématique de la résistance à la colonisation.
Il n’est pas certain du tout que ces voix soient entendues tant l’atmosphère a changé autour d’Emmanuel Macron. Ni sa coalition avec la droite ni son alliance renouvelée avec le Maroc ne le poussent à renouer avec l’Algérie. Son entourage aussi a changé, plus conservateur qu’avant. Un de ses proches, rallié du second mandat, confie par exemple : « On a fait les gentils avec l’Algérie et ça n’a pas marché. Franchement, ça suffit de se faire marcher dessus. »
Source : Mediapart – 15/01/2025 https://www.mediapart.fr/journal/politique/150125/france-algerie-retailleau-tente-d-entrainer-macron-dans-sa-bataille