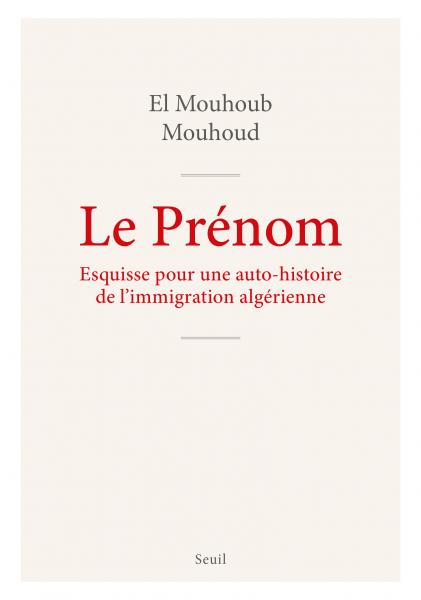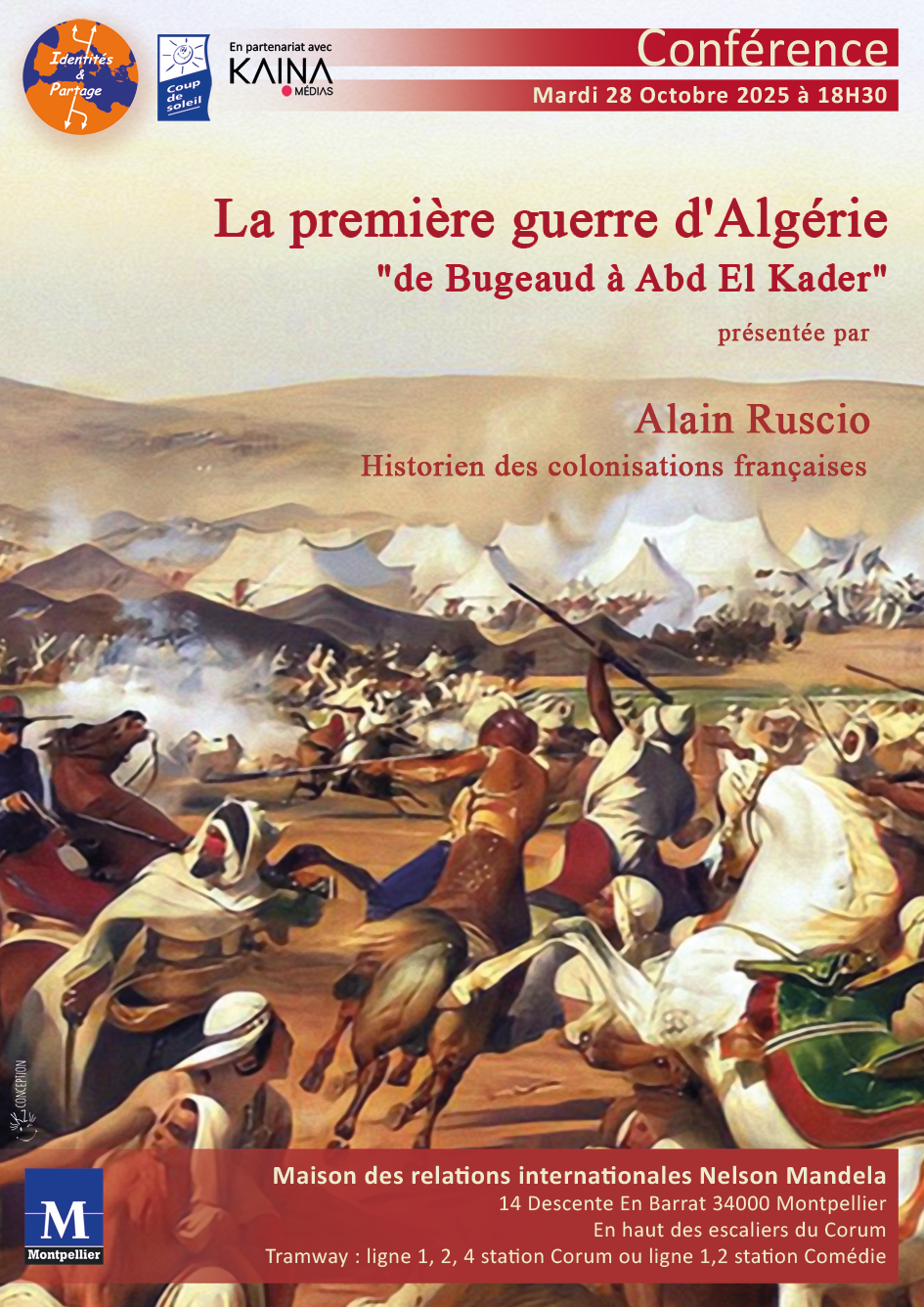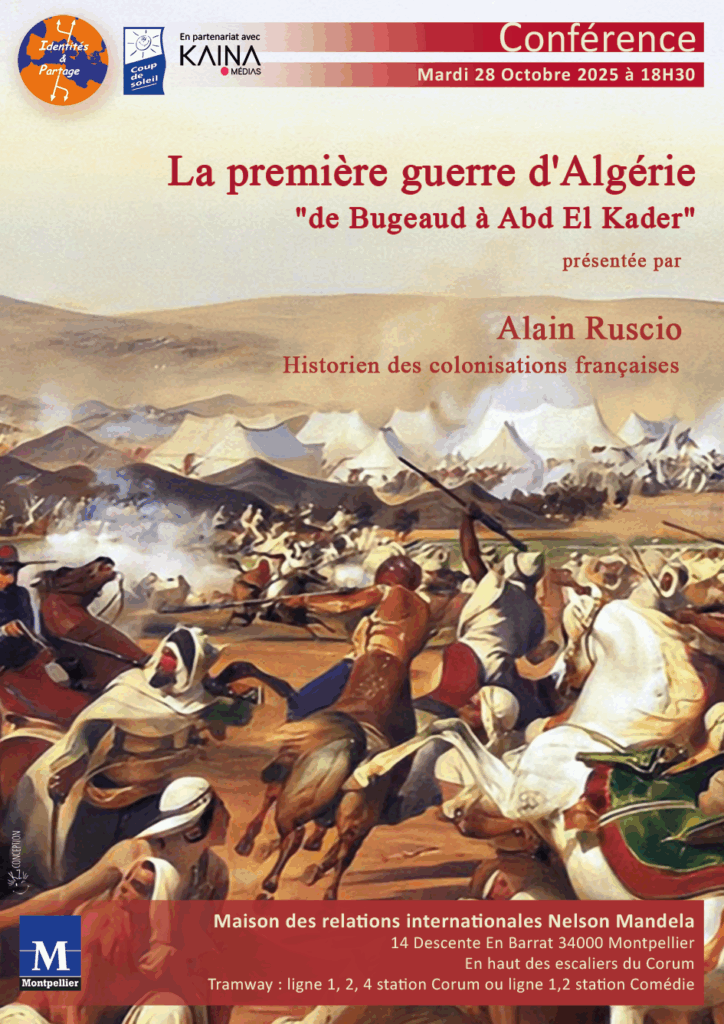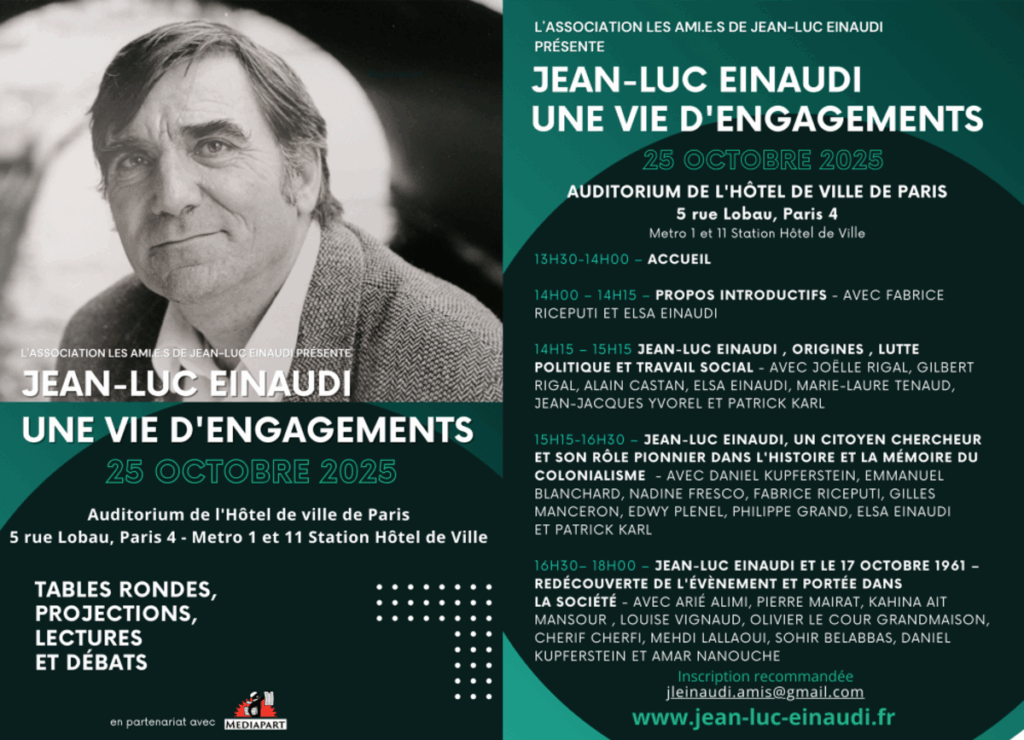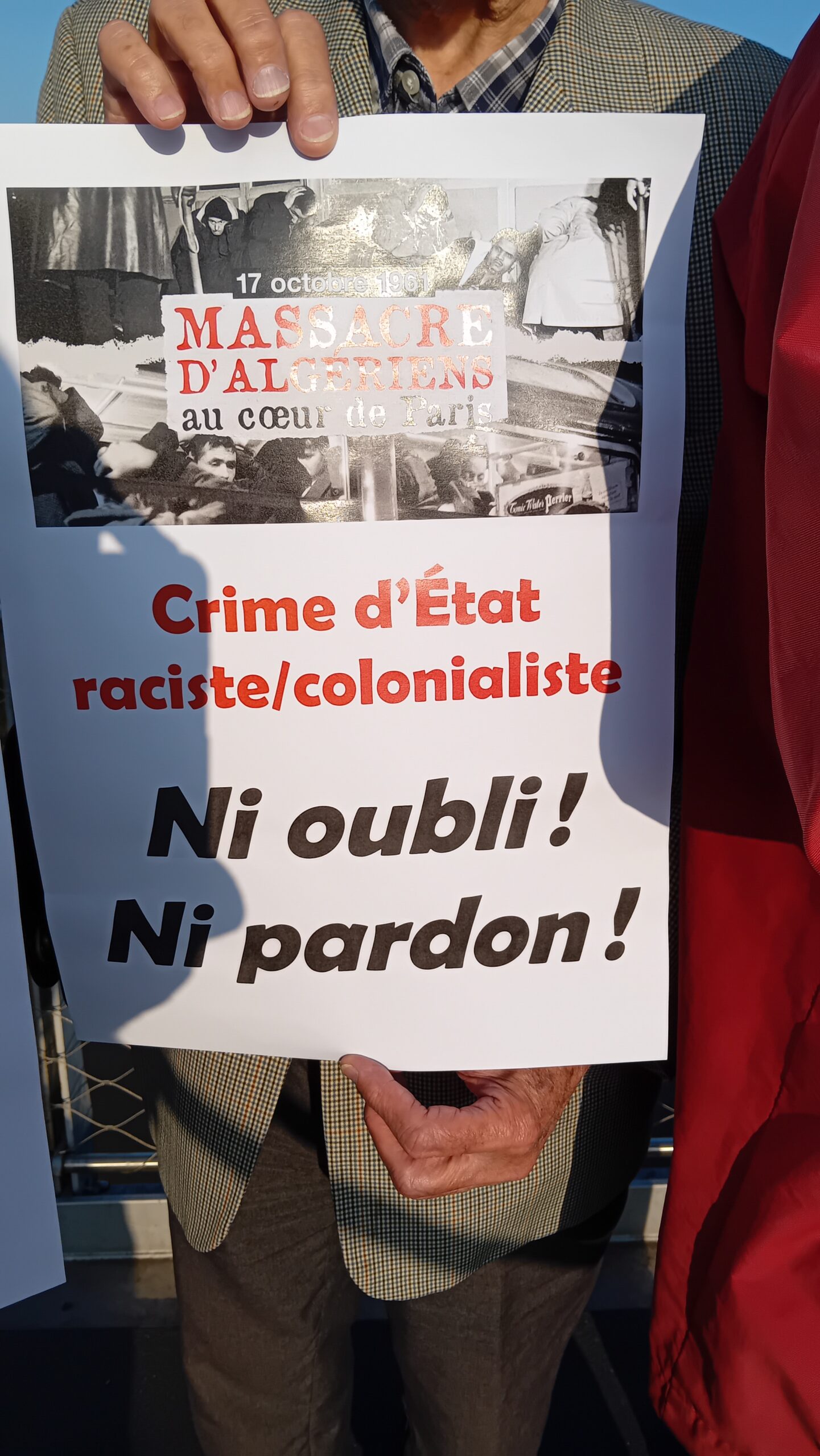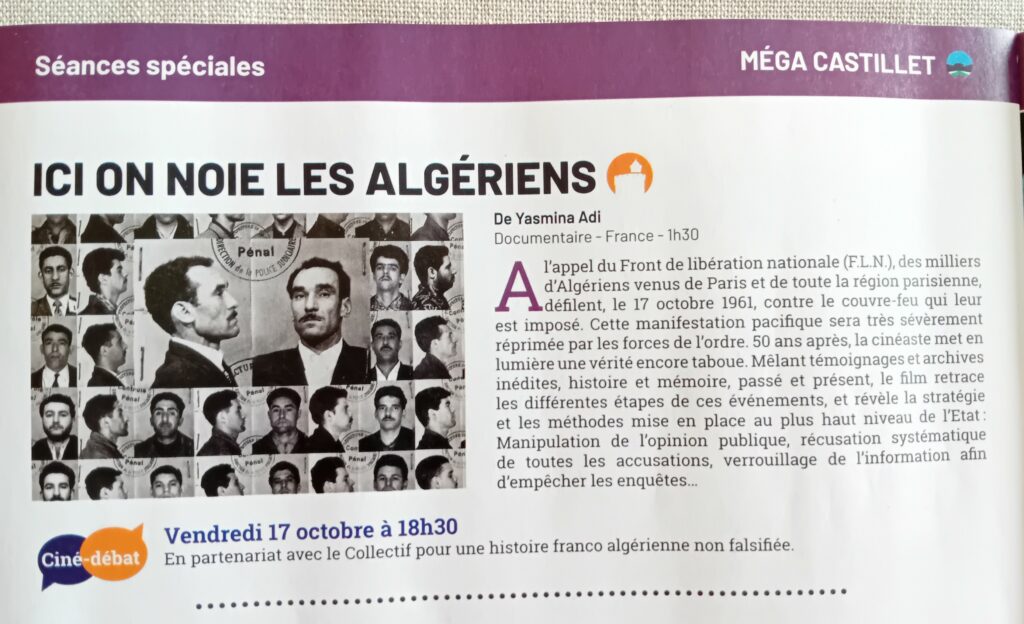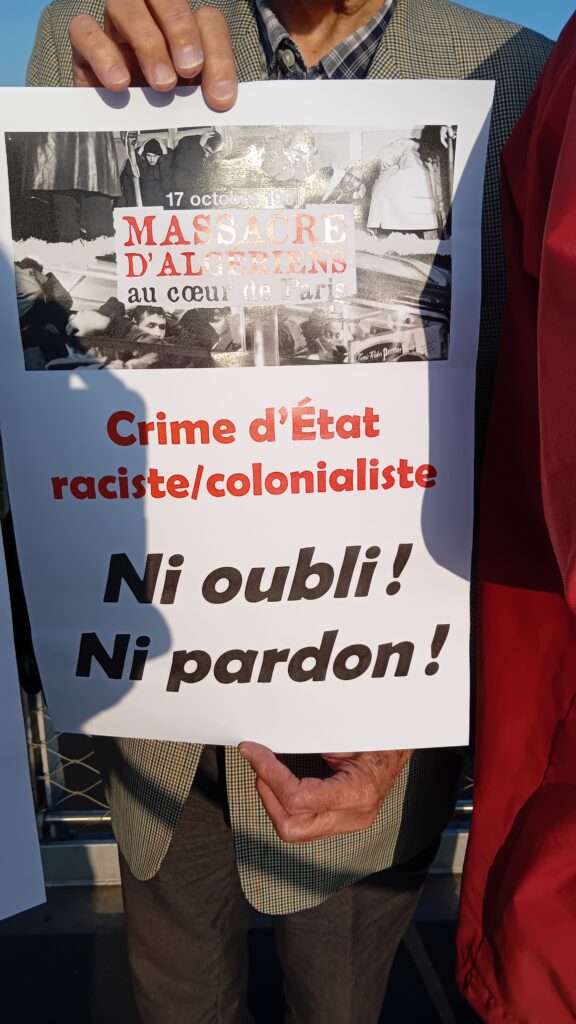Conçu pour faciliter l’immigration économique et pallier le besoin de main d’œuvre des Trente Glorieuses, l’accord prévoyait la libre circulation entre les deux pays pour les ressortissants algériens. Vidé de son contenu au cours des ans, le texte n’a aucune influence sur les flux migratoires ; pourtant la droite se mobilise pour l’abroger, ce qui lui permet d’agiter ses fantasmes sur l’invasion du pays.
Tout commence le 25 mai 2023 avec la publication de Politique migratoire : que faut-il faire de l’accord franco-algérien de 1968 ?, une étude de Xavier Driencourt, ancien ambassadeur français en Algérie (cf. https://anpnpa.fr/accords-de-1968-lextreme-droite-francaise-revient-a-la-charge-m-abdelkrim/). La réponse à la question du titre est claire : il faut abolir un texte largement oublié de tous, sinon de ses « bénéficiaires », parce qu’il favorise en France l’immigration algérienne, objet de peurs et de fantasmes dans une partie de la population.
L’ accord mettait fin à une tension sérieuse entre la France et l’Algérie au sujet du nombre d’Algériens admis en France. Paris avait réduit unilatéralement à 1 000 par mois le nombre des admis à compter du 1er juillet 1968. Trois ans après le coup d’état militaire du colonel Houari Boumediene, son ministre des affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika (qui deviendra trente ans plus tard chef de l’État) et l’ambassadeur de France en Algérie Jean Basdevant signent le 27 décembre 1968 un accord qui admet chaque année 35 000 travailleurs algériens sur le territoire français. Ils sont autorisés à y séjourner au préalable neuf mois pour y trouver un emploi — ce qui n’a rien d’un exploit dans la France des Trente Glorieuses où le taux de croissance annuel atteint 5 % et où les usines manquent de bras. En cas de réussite, les candidats à l’immigration obtiennent une carte de séjour valable 5 ans pour eux et leurs familles. Les touristes algériens munis d’un passeport peuvent entrer librement et séjourner trois mois dans l’Hexagone. Paris s’engage en outre à améliorer la formation professionnelle et les conditions de logement des immigrés, trop souvent cantonnés aux emplois les plus ingrats et souvent logés dans des bidonvilles.
Un traité sans cesse revu à la baisse
Le démarrage de l’accord est poussif : à peine 30 000 travailleurs sont admis en 1969, première année d’application. Environ 20 000 femmes et enfants sont entrés en France mais « il y a eu un nombre à peu près égal de sorties » note le professeur André Adam dans une chronique scientifique1.
Les Algériens profitent-ils de leur traitement dérogatoire au Code d’entrée et de séjour des étrangers (Codesa) ? Pas vraiment. Sans accord équivalent, les Marocains, peu nombreux à l’époque en France, arrivent en plus grand nombre, rattrapent leur retard et font aujourd’hui jeu égal avec les Algériens.Bas du formulaire
Fin 1985, à la veille d’élections difficiles et en pleine montée du chômage, le premier ministre Laurent Fabius abroge l’article 1 (l’admission de 35 000 travailleurs chaque année) et l’article 2 (les 9 mois de séjour pour trouver un emploi). Le texte est réécrit dans un sens restrictif. Deux autres avenants lui succéderont en 1994 et 2001. La partie « entrée » de l’accord est désormais supprimée, la partie « séjour » demeure partiellement en vigueur. Un an plus tard, le visa est instauré et devient la clé de l’entrée en France des étrangers. C’est le vrai régulateur pour les 800 000 étrangers qui entendent se rendre dans l’Hexagone. Il éclipse un peu plus encore l’accord franco-algérien, privé de muscle depuis trois ans. Ses adversaires d’aujourd’hui tirent à côté de la cible, la carte de séjour remplacée par le certificat de résidence bénéficie à environ 600 000 Algériens établis en général depuis longtemps, avantagés par quelques « privilèges », comme l’accès immédiat au revenu de solidarité active (RSA) sans avoir à attendre plusieurs années comme les autres immigrés.
Déjà, fin 2022, prenant tout le monde de vitesse, la première ministre Elizabeth Borne pressent le vent qui se lève à droite. Au cours d’une visite officielle en Algérie, elle annonce à ses hôtes qu’elle prépare une « révision » de l’accord. Un quatrième avenant est prévu. Pour quoi faire ? Rien ne filtre, sinon la vague promesse d’améliorer le sort des 32 000 Français qui vivent en Algérie et sont pour l’essentiel des binationaux détenteurs de deux passeports, l’un pour sortir d’Algérie, l’autre pour entrer en France…
L’ accueil est frais. La presse algérienne y voit une violation des Accords d’Évian, largement enterrés depuis 1962 par les deux parties. D’autres, comme l’ancien député socialiste au Parlement européen Kamel Zeribi dénonce « un coup porté aux relations franco-algériennes ». En réponse, le président Abdelmajid Tebboune précise dans un entretien au Figaro en décembre 2022 : « La mobilité des Algériens en France a été négociée et il convient de la respecter. Il y a une spécificité algérienne même par rapport aux autres pays maghrébins ». À demi-mot, on comprend que l’honneur du pays est en cause.
Inquiétante évolution de la société
L’ étude de Xavier Driencourt fait un retour remarqué dans la vie politique française au début de l’été 2023. Dans une interview largement reprise2, l’ancien premier ministre Édouard Philippe reprend la balle et appelle à son tour à l’abrogation de l’accord. Le 26 juin, Bruno Retailleau, président du groupe des Républicains au Sénat, et plusieurs de ses collègues déposent une proposition de loi en faveur, elle aussi, de l’abrogation.
Enfin, le 7 décembre, le groupe des députés Les Républicains à l’Assemblée nationale dépose à son tour une proposition de loi en faveur de la fin de l’accord de 1968. L’exposé des motifs des deux textes, à l’Assemblée comme au Sénat, reprend sans en changer une ligne la première page du rapport Driencourt. L’Assemblée rejette le projet par 151 voix contre 114, soit l’addition des Républicains et des députés d’Horizons, le groupuscule d’Édouard Philippe au Palais-Bourbon, plus quelques isolés. Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen s’abstient de peur de renforcer son rival numéro 1 et le gros du groupe Renaissance l’imite pour respecter l’injonction du président Emmanuel Macron qui ne veut pas que le Parlement se mêle d’un dossier sensible entre Paris et Alger. Enfin, l’opposition au texte des Républicains, majoritaire, se recrute uniquement à gauche et fait le plein des 151 députés de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).
Que retenir d’un épisode parlementaire, gouvernemental et diplomatique marginal comparé à la « loi Immigration » et à ses 95 articles adoptés quelques jours plus tard ? Sans doute rien, l’opinion l’a ignorée et l’Assemblée l’a rejetée. C’est pourtant un signe supplémentaire d’une inquiétante évolution de la société française. Le développement décomplexé d’un fort courant politico-médiatique ouvertement hostile aux immigrés — surtout, disons-le, aux musulmans — se nourrit de la crise politique née de l’absence d’une majorité favorable au président Emmanuel Macron à l’Assemblée. Le centre droit en déclin court après l’extrême droite et reprend ses discours sur un sujet (l’immigration) qui vient dans les préoccupations des Français bien après le pouvoir d’achat, la santé, l’environnement et les inégalités3. Le pays n’a en vérité besoin ni de la disparition de l’accord de 1968 ni de la loi fourre-tout du ministre de l’intérieur, votée in fine par les lieutenants de Marine Le Pen, et qui n’aura aucun impact sur les flux migratoires.
Notes
1. Annuaire de l’Afrique du Nord, tome VIII, CNRS, 1969 ; page 468.
2. « Édouard Philippe : immigration « subie », Algérie, délinquance… « On crève des non-dits » L’Express, 5 juin 2023.
3. NDLR. Voir par exemple « 70% des Français se déclarent pessimistes quant à l’avenir de la France », Ipsos, 26 octobre 2023.
Source : Orient XXI – 11/01/2024 https://orientxxi.info/magazine/en-finir-avec-l-accord-franco-algerien-de-1968-une-obsession-de-la-droite,6989