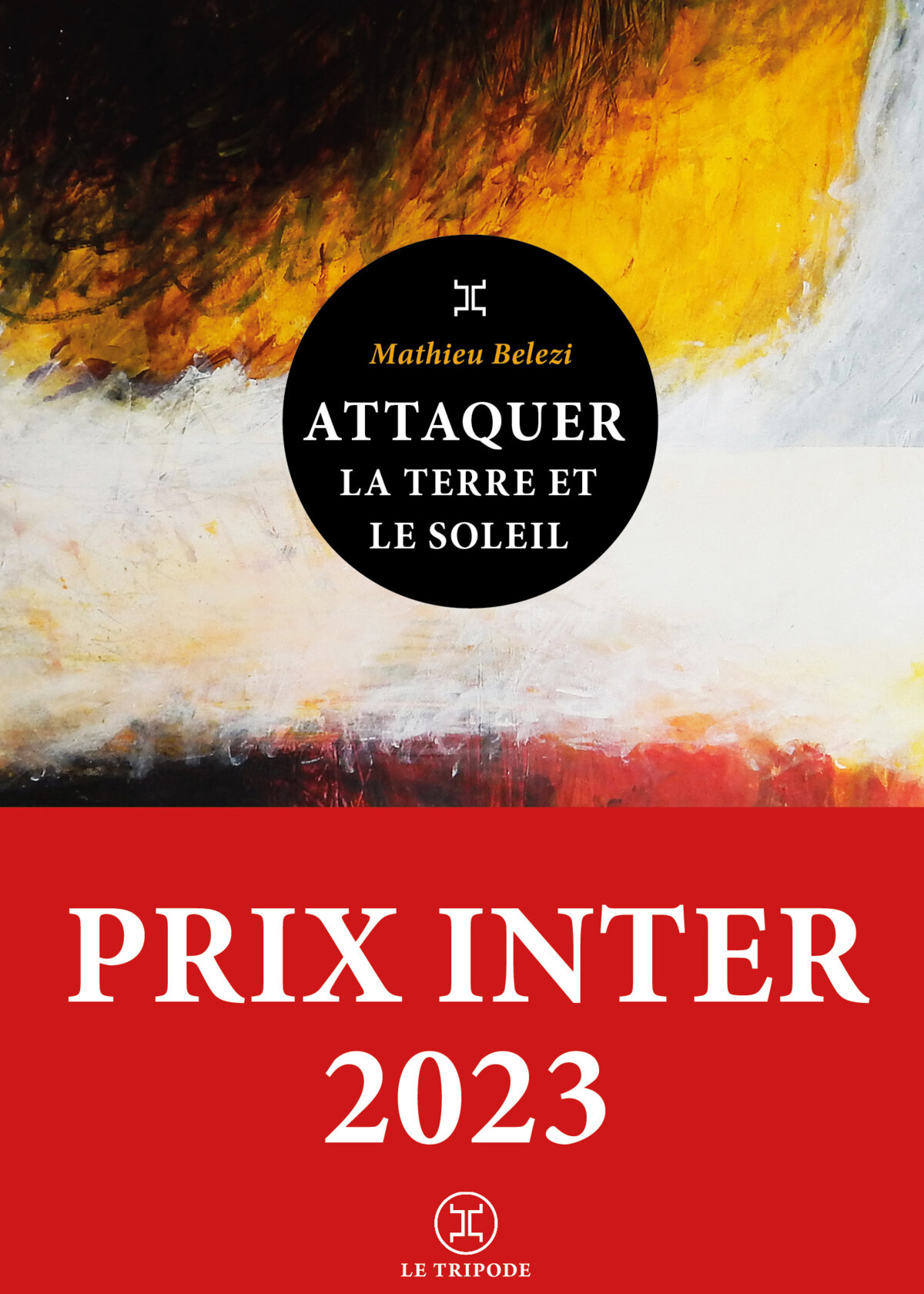Lauréat du prix du Livre Inter en 2022 avec « Attaquer la terre et le soleil », l’écrivain Mathieu Belezi documente depuis des années la férocité de la colonisation en Algérie. Il constate à nouveau l’ignorance entêtée que notre pays entretient autour des massacres qui l’ont accompagnée.
Dans Attaquer la terre et le soleil (éd. Le Tripode, 2022), Mathieu Belezi raconte le quotidien infernal des tout premiers colons d’Algérie, arrivés miséreux des campagnes hexagonales pour un lopin de terre, malades de fièvre, protégés tant bien que mal des assauts des Algériens expropriés par une armée française qui commet massacre sur massacre.
Avant qu’il ne reçoive en 2022 le prix du Livre Inter pour ce récit, l’Algérie coloniale était depuis longtemps un de ses thèmes de prédilection, déplié depuis 2001 avec Les Vieux Fous,récit halluciné de la vie et de la chute d’Albert Vandel, « l’homme le plus riche d’Alger » en 1962, C’était notre terre (2008), ou encore Un faux pas dans la vie d’Emma Picard (2015) – des livres quasiment tous réédités en 2024 par les éditions Le Tripode sous les titres Moi, le glorieux, Le Temps des crocodiles et Emma Picard.
Pour l’émission « À l’air libre » du 6 mars sur les tensions entre la France et l’Algérie, Mathieu Belezi avait accepté un entretien lors duquel nous abordions l’ignorance et les résistances de la société française face aux crimes de la conquête algérienne, la question de la mémoire et son instrumentalisation par les politiques. Nous publions l’intégralité de cet entretien, réalisé le dimanche 2 mars.
Mediapart : Bruno Retailleau a alimenté ces derniers mois une surenchère verbale contre l’Algérie, Jean-Michel Aphatie a été vilipendé pour avoir rappelé les massacres de l’armée française au XIXe siècle, et l’extrême droite, indignée et offusquée, a parlé de la colonisation comme d’une« bénédiction ». Que vous a inspiré cet épisode, vous qui racontez ces réalités depuis deux décennies ?
Mathieu Belezi : Je ne suis pas étonné que nos dirigeants et les dirigeants de l’Algérie puissent s’invectiver et faire monter une espèce de dispute. Entre la France et l’Algérie, rien n’est réglé. Chaque Français, et je pense chaque Algérien, a au fond de lui cette mémoire qui est en train de moisir et qui ne sort pas. Ce contentieux, on n’en parle pas. À la place, on fait monter une espèce de tension, de ressentiment et de violence.
C’est comme si on revenait aux années 1960 : « L’Algérie, c’est la France. » Bruno Retailleau a-t-il lu l’histoire de la conquête de l’Algérie d’Alain Ruscio [La Première Guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, éd. La Découverte, 2022 – ndlr] ou bien le livre de Pierre Darmon [Un siècle de passions algériennes. Une histoire de l’Algérie coloniale, 1830-1940, éd. Fayard, 2009 – ndlr] ? J’aimerais lui poser la question.
Que comprendrait-il s’il les lisait ?
Ce qui se cache derrière les images d’Épinal de la colonisation. Entre 1830 et 1870, il y a eu quarante ans de guerre inadmissible, terrible, raciste. Nous avons été des barbares. Pourquoi la France a-t-elle pu se comporter de la sorte ? Je repense très souvent à une déclaration d’Emmanuel Macron, qui a dit en 2022 : « Entre la France et l’Algérie, c’est une histoire d’amour qui a sa part de tragique. » Mais comment cela peut-il être une histoire d’amour ?
Tant que nous n’aurons pas fait ce travail d’« affronter l’entaille », comme dit l’historien Patrick Boucheron, on ne s’en sortira pas. Il ne s’agit pas de culpabiliser nos générations. Mais qu’on accepte de reconnaître ce qui s’est passé au XIXe siècle, et ce qui a perduré, comme l’a montré Pierre Bourdieu, qui parlait à la fin de la colonisation de la population algérienne des campagnes de sa misère effroyable, de la famine. Si on mettait tout ça sur la table, ça soulagerait beaucoup de Français et beaucoup d’Algériens.
Emmanuel Macron a fait un certain nombre de gestes mémoriels. Ils auraient dû être faits il y a dix ou vingt ans. La clé, ce serait de reconnaître la torture en Algérie.
La surenchère verbale du ministre, les réactions des éditorialistes et médias ou élus conservateurs et d’extrême droite ces dernières semaines nous montrent qu’il semble très facile de réactiver en France la rancœur, un antagonisme contre l’Algérie. Que cela nous dit-il de la France ?
Là encore, aucun étonnement. À sa sortie, le livre de Pierre Darmon qui disait la vérité historique n’a eu aucune presse. Et quand il est sorti en poche chez Perrin, en 2015, les 270 premières pages qui concernaient les toutes premières décennies de la colonisation entre 1830 et 1870 ont été censurées – j’appelle ça une censure. Il y a un réseau très puissant qui s’active à chaque fois très facilement. Moi aussi j’ai connu des censures. Mon roman Attaquer la terre et le soleil a eu du succès, mais je n’ai jamais été invité à la télévision pour en parler. En Belgique oui, mais pas en France. Le Théâtre de la Liberté à Toulon (Var) avait pris une option pour une adaptation sur scène de C’était notre terre, mais au bout d’un an ils ont dû renoncer.
Une comédienne a fait une adaptation d’Emma Picard et elle a du mal à la faire tourner dans des petites villes. À Rome, j’ai fait un jour une présentation d’un de mes romans qui ne parlait pas du tout de l’Algérie, et l’ambassadeur avait fait savoir que ce serait mieux que je ne parle pas de l’Algérie. C’était notre terre est à nouveau en train d’être adapté au théâtre, avec une création prévue pour l’an prochain en région parisienne, puis à Genève. Je suis curieux de voir quelle sera la réaction.
Le souvenir des enfumades de Bugeaud, massacres de tribus entières, a été rappelé par Jean-Michel Aphatie, qui les a comparées à autant d’« Oradour-sur-Glane ». Vos romans, qui par ailleurs ne cachent rien des immenses difficultés auxquelles ont été confrontés les colons venus dans le sillage de l’« armée d’Afrique », sont parsemés de ces massacres.
Dans un des romans, j’ai imaginé un épisode qui ressemble aux enfumades. Au fond, je ne comprends toujours pas. Comment on peut en arriver là ? Comment l’Europe qui au XIXe siècle, par d’autres aspects, était quand même une sorte de phare culturel du monde a pu faire ça ? Dans mes romans, je fais très attention à ne pas en rajouter dans la violence parce que ce n’est pas peine, il y en a assez dans la vérité historique dont je me suis inspiré.
Tous les Français devraient savoir ce qu’ont été les enfumades du Dhara. Tous les Français devraient lire les livres qui parlent de cette époque. Au moins pour essayer de comprendre cette colonisation furieuse qui concerne toute l’Europe. Parce que ce n’est pas seulement la France : c’est l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, comme le raconte David Van Reybrouck dans Congo. Une histoire.
Pour nous, Européens, c’est très important parce que nous pouvons très vite retourner dans la barbarie, et je suis bien placé pour en témoigner pour vivre en Italie, où beaucoup font comme si ce gouvernement d’extrême droite était un gouvernement comme les autres. On ne doit rien lâcher. Et on doit cesser de mettre l’histoire sous le tapis.
Quand vous avez commencé à écrire, était-ce pour combler ce manque de récits sur la colonisation ?
Pas vraiment. Le premier livre sur l’Algérie, C’était notre terre, c’était d’abord un travail littéraire sur la langue, sa musicalité. Je connaissais assez peu de choses sur l’Algérie coloniale, mais j’avais le sentiment que cette histoire, à cause de sa folie, pouvait bien convenir à mon travail d’écriture, au style que je voulais avoir, dans son baroquisme, sa démesure. J’ai cherché une manière de raconter les choses.
C’est vrai, je m’étais dit que la littérature française n’avait pas abordé la conquête algérienne. Cela m’étonnait. Je n’avais pas conscience que cela heurterait, que je me confronterais à une résistance qui ne dit pas son nom. En revanche, c’est cette résistance qui m’a donné envie de continuer. Même si ça a été une période difficile pour moi. Attaquer la terre et le soleil avait été refusé par cinq ou six grands éditeurs avant d’être publié par les éditions Le Tripode. J’en étais à me dire : voilà, à l’âge que j’ai, j’ai raté mon coup, je continuerai à écrire mais je ne publierai plus.
Le succès de vos livres montre aussi que beaucoup de gens sont avides de connaître cette histoire…
Dans les rencontres en librairie, il y a de vieux Algériens qui me remercient, des pieds-noirs avec qui je discute. Je me rappelle une présentation que j’avais faite pour C’était notre terre avec des libraires. Une dame d’une cinquantaine d’années était venue me voir à la fin : elle découvrait que l’armée française n’avait pas été accueillie à bras ouverts quand elle a débarqué en Algérie. Bref, on ne sait pas ! Et quand on découvre, c’est terrible. Raison de plus pour tout mettre sur la table. Même si, dans le contexte politique actuel, en effet, ce n’est pas gagné.
Source : Médiapart – 22/03/2025 https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/220325/mathieu-belezi-en-algerie-nous-avons-ete-des-barbares