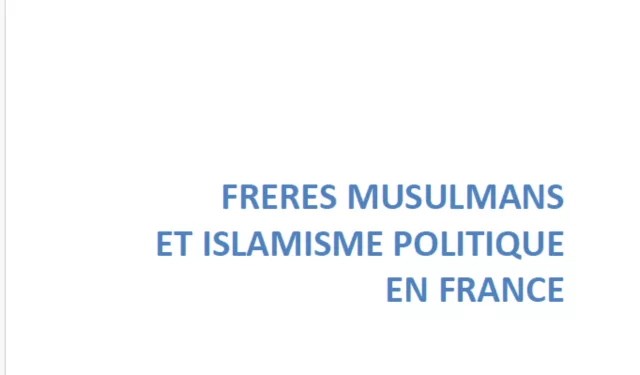Le rapport sur l’influence des Frères musulmans en France, dont la version définitive vient d’être publiée, est loin d’être aussi alarmiste que ce qu’a tenté de faire croire Bruno Retailleau. Les chiffres, mis en perspective, montrent en réalité un repli de leur influence.
Tout ça pour ça. Le rapport sur les frères musulmans a occupé la communication gouvernementale toute la semaine. Une première version avait fuité dans Le Figaro mardi 20 mai, la veille de sa présentation en Conseil de défense, ce qui avait agacé Emmanuel Macron. Le ministère de l’intérieur a finalement publié officiellement vendredi soir le rapport, toujours expurgé de certains passages pour des raisons de sécurité.
Loin des formules sensationnalistes du ministre de l’intérieur, ce rapport laisse voir une influence réelle mais relativement limitée, et surtout en déclin, de la mouvance frériste dans le paysage musulman français. Tenu par la commande politique formulée par Gérald Darmanin il y a un an, qui voulait que ce document provoque un « choc » dans l’opinion, le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » avance l’idée d’une réelle menace pour la République, en restant souvent très flou.
À des passages factuels et neutres succèdent des assertions vagues aux accents parfois complotistes, ce qui fait penser à un rapport palimpseste, qui a manifestement subi plusieurs réécritures et dont une vingtaine de pages restent caviardées. Décryptage.
- Une mouvance en déclin
Le frérisme en France, combien de divisions ? Pour le savoir, il faut d’abord passer par 40 pages consacrées à l’histoire des Frères musulmans, un mouvement sunnite créé en Égypte par Hassan el-Banna avec l’ambition de réislamiser les fidèles dans le contexte colonial marqué par la domination britannique. Puis arrive enfin l’Hexagone : les membres de la confrérie en France seraientaujourd’hui « entre 400 et mille personnes », estime le rapport. Il ne précise pas que ce nombre – difficile à établir, compte tenu de la tradition de secret de la confrérie – est tendanciellement en baisse, comme tous les spécialistes interrogés par Mediapart nous l’ont confirmé (voir notre boîte noire). Revendiquant l’héritage frériste, l’association Musulmans de France, qui gère notamment des lieux de cultes, est historiquement considérée comme la branche française des Frères musulmans, même si ses cadres assurent n’avoir plus de liens organiques avec la confrérie.
Le rapport recense 139 lieux de cultes « affiliés à Musulmans de France »,et68 autres considérés comme « proches » de la mouvance frériste.Soit, au total, seulement 7 % des mosquées. Bernard Godard, qui a suivi au ministère de l’intérieur l’islam de France pendant près de quinze ans, rappelle qu’il y avait plus de 250 mosquées affiliées à l’UOIF (Union des organisations islamiques de France, ancêtre de Musulmans de France) à la fin des années 1990.
La photographie du monde caritatif est tout aussi parlante. Sur la trentaine d’ONG considérées comme « islamistes », 16 sont « dirigées par des salafistes », un courant sunnite concurrent marqué par une lecture littéraliste et rigoriste des textes. Mais le rapport en identifie seulement quatre « relevant ou ayant relevé de la mouvance frériste ». Une fois de plus, difficile de voir dans cette mouvance la principale menace dans l’offre islamiste, alors que le salafisme n’a cessé de gagner du terrain ces dernières années.
Le budget de Musulmans de France, 500 000 euros annuels, a baissé de moitié depuis cinq ans. La structure n’est plus en mesure d’organiser ses grands rassemblements du Bourget, qui pouvaient attirer jusqu’à 100 000 personnes. « Leur rassemblement annuel se fait maintenant dans un hall d’hôtel où l’on voit des cadres de plus en plus vieillissants, précise sur ce point le chercheur Haoues Seniguer auprès de Mediapart.
Si Musulmans de France ne revendique que 53 associations affiliées, essentiellement religieuses, avec des « coopérations » avec une cinquantaine d’autres structures, le rapport affirme qu’il y aurait en réalité 280 associations reliées à la structure. Sans plus de précisions. Pour Bernard Godard, elles étaient « plus de 400 il y a quinze ans ».
Le reflux de l’influence frériste s’explique aussi par la vague de répression contre cette mouvance, en particulier depuis l’adoption de la loi sur le séparatisme. Le rapport en donne plusieurs exemples : expulsion de l’imam Iquioussen, dissolution du Comité contre l’islamophobie en France (CCIF)… Mais aussi fermeture de certaines structures et des enquêtes diligentées contre des associations comme Humani’terre ou Al Wakt al Islami pour financement d’entreprise terroriste.
- Les mensonges de Retailleau sur la charia et le califat
La veille de la parution de la première version du rapport, Bruno Retailleau a employé des formules des plus alarmistes : « L’objectif ultime est de faire basculer toute la société française dans la charia », a-t-il lancé aux journalistes, à propos de cette grande loi islamique qui risquerait de supplanter les lois de la République.
Ledit rapport énonce pourtant précisément l’inverse : « Aucun document récent ne démontre la volonté de Musulmans de France d’établir un État islamique en France ou y faire appliquer la charía », lit-on dans ses conclusions.
Le terme de charia n’y apparaît d’ailleurs qu’une seule autre fois, au niveau du glossaire : « Grande loi islamique à la fois religieuse et sociale suivie par les musulmans des États islamiques qui englobe certains principes de droit ». Et de préciser qu’elle « ne s’applique pas de la même manière et selon les mêmes règles, dans les différents États qui l’ont adoptée », concédant ainsi la difficulté d’en définir les contours.
La rapport n’indique à aucun moment que la mouvance française aurait aujourd’hui le projet d’instaurer un califat, contrairement là encore aux déclarations tonitruantes du ministre de l’intérieur.
- Confusion entre salafisme et frérisme
À plusieurs reprises, le rapport pointe une hybridation entre les salafistes et la mouvance frériste. Cette thèse, développée notamment par la chercheuse Florence Bergeaud-Blackler, qui parle de « fréro-salafistes », est controversée et minoritaire dans le champ académique. Sur le terrain, des chercheurs et chercheuses comme Brigitte Maréchal, spécialiste du frérisme européen, décrivent plutôt une concurrence féroce entre ces tendances de l’islam sunnite.
Mais ce flou conceptuel permet au rapport de passer sans grande logique de la dénonciation d’un fonctionnement typiquement issu de la tradition frériste à celle de pratiques notoirement associées au salafisme.
- Une même poignée d’établissements scolaires pointés du doigt
« Vingt et un établissements musulmans » en France seraient « liés à la mouvance des Frères musulmans », pour un total de 4 200 élèves, établit le rapport. Cinq établissements musulmans seulement ont un contrat avec l’État – le rapport ne dit pas que 96 % des établissements sous contrat en France sont catholiques, ce qui concernait 2 millions d’élèves en 2023.
Parmi ces établissements, il y a un binôme désormais incontournable : Averroès (Lille) et Al-Kindi (Lyon), deux groupes scolaires qui épousent la même destinée. À un an d’écart, leur contrat d’association avec l’État a été résilié par une décision de préfecture. Des motifs similaires ont été invoqués : une comptabilité pas assez carrée, des financements étrangers et des manquements aux « valeurs de la République ».
Le rapport omet de rappeler, comme l’ont révélé Mediapart et Mediacités, que les rapports de préfecture ont été tronqués pour monter des dossiers à charge. Tout juste est-il glissé qu’Averroès a eu gain de cause en avril, quand le tribunal administratif lillois a annulé la résiliation de son contrat, estimant que « les manquements ne sont pas suffisamment établis ».
Paradoxalement, le rapport souligne le fait que « les enfants scolarisés n’y sont pas, loin s’en faut, par des parents affiliés à la mouvance », car « un grand nombre d’entre eux recherche davantage l’excellence scolaire que proposent les écoles fréristes », le qualificatif lui-même étant rejeté par le personnel éducatif. « Ici, que ce soient les élèves ou n’importe qui d’autre, personne ne sait ce qu’est un frère musulman », s’est ému le directeur adjoint d’Al-Kindi, lorsque Mediapart l’a rencontré en janvier 2025.
- Le sport
À entendre les sénateurs et sénatrices et une grande partie des ministres du gouvernement Bayrou ces derniers mois, l’urgence serait d’interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Pourtant, ce rapport sur l’entrisme ne consacre que quelques paragraphes au sport, reprenant des données éculées qui circulent depuis des années et en omettant soigneusement d’autres.
Il passe ainsi sous silence les conclusions du rapport Sporad, produit par les services de recherche du ministère de l’intérieur, qui montrent qu’il « n’y a pas de phénomène structurel, ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport ».Rendu en 2022, ce document a été mis de côté par le ministère de l’intérieur, jusqu’à ce que Mediapart le mette au jour en mars 2025.
Le rapport déclassifié sur l’entrisme mentionne qu’« en 2020, 127 associations sportives étaient identifiées comme “ayant une relation avec une mouvance séparatiste” ». Le rapport Sporad, lui, observe que « le nombre d’associations sportives “séparatistes” est passé de 127 à 62 » entre 2019 et 2021, une forte baisse, « alors même que les services ont déployé plus d’efforts pour identifier des cas », notent les chercheurs et chercheuses.
- L’obsession des municipales
L’entrisme de la mouvance aux municipales apparaît comme l’une des principales menaces pointées par le rapport. « Le danger d’un islamisme municipal, composite au plan idéologique mais très militant, avec des effets croissants dans l’espace public et le jeu politique local, apparaît bien réel »,note le rapport reprenant une vieille marotte de Bruno Retailleau, qui a déposé une proposition pour faire interdire les listes communautaires en 2019.
Le rapport indique que « certains spécialistes consultés considèrent que d’ici une dizaine d’années des municipalités seront à la main d’islamistes, comme en Belgique »,sans aucune autre précision sur la réalité d’un phénomène qui n’a pour l’instant jamais décollé en France.
Les listes communautaires musulmanes ont en effet été très peu nombreuses aux dernières élections municipales et ont recueilli très peu de voix. Sur la dizaine de listes recensées, aucune n’a été élue et leur score a rarement dépassé les 2 %.
- Une logique du soupçon…
De nombreux passages du rapport mettent en doute la sincérité des organisations se référant à l’héritage frériste. Toutes les affirmations de Musulmans de France sur son éloignement de la confrérie sont considérées comme relevant du double discours ou de la dissimulation. Leur projet de réorganisation en fédérations thématiques, pour pallier le manque de cadres, viserait en réalité « à laisser accroire qu’il ne s’agit plus d’entités fréristes et à rendre plus difficiles les éventuelles entraves dont ils pourraient faire l’objet », lit-on.
Même lorsque Musulmans de France signe la charte des principes pour l’islam de France, présentée comme un refus du « séparatisme », ce choix «n’est probablement pas sans lien avec la crainte des cadres dirigeants d’une dissolution administrative », avance le rapport.
Manifestement, les rapporteurs ne croient pas non plus au choix de l’organisation de s’en tenir aux questions strictement religieuses, qu’ils estiment être « artificieux ».
Les nombreux chercheurs interrogés ces derniers jours précisent pourtant qu’une évolution des acteurs de la mouvance a bien eu lieu ces vingt dernières années. Haoues Seniguer préfère d’ailleurs parler de « néofrérisme », pour marquer cette adaptation au contexte français et l’acculturation des cadres comme des sympathisants au cadre laïque.
Si la tradition de secret de la confrérie, héritage de la répression subie en Égypte dès sa création, pèse dans cette interprétation, le rapport n’apporte aucun élément tangible de cette dissimulation aujourd’hui. À sa lecture, toute manifestation visible de l’islam, de la consommation hallal au port du voile, est potentiellement suspecte.
- … et des nuances écrasées par la communication
Cet air de soupçon généralisé va paradoxalement à l’encontre d’autres passages du rapport. « Le reste du corps social doit accepter que l’islam est une religion française, très probablement l’une des toutes premières sinon la première en termes de pratique cultuelle, et mérite à cet égard de la considération, y compris vis-à-vis de certaines de ses mœurs qu’il ne partage pas », lit-on par exemple.
Plusieurs préconisations fortes du rapport, concernant les signaux à envoyer à une communauté musulmane en proie à un « sentiment de rejet » comme l’apprentissage de l’arabe à l’école, les carrés musulmans dans les cimetières ou la reconnaissance d’un État palestinien, ont aussi étrangement été passées à la trappe dans la communication outrancière de la Place Beauvau ces derniers jours.
Boîte noire
Pour décrypter ce rapport Mediapart a interrogé plusieurs chercheurs comme Haouès Seniguer, Franck Frégosi ou Margot Dazey. Bernard Godard, qui a été chargé pendant plus de quinze ans de la question de l’islam au ministère de l’intérieur, nous a également aidé à mettre en perspective les chiffres présentés dans ce rapport.
Pour l’enquête sur le livre de Florence Bergeaud-Blackler consacré au frérisme, nous avions également échangé sur le phénomène avec Brigitte Maréchal, Vincent Geisser ou Elyamine Settoul.
Source : Mediapart – 24/05/2025 https://www.mediapart.fr/journal/politique/240525/freres-musulmans-decryptage-d-un-rapport-qui-se-degonfle