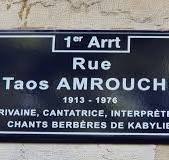Hommage au vieux lutteur, à l’ami, à l’intellectuel qui a tenu bon contre vents et marées pour défendre l’émancipation humaine.
Le mardi 13 janvier 2026, ont lieu les obsèques de Mohammed Harbi. Je m’en tiendrai ici à des réflexions personnelles. Sur ses travaux et sa pensée, je renvoie à l’excellent texte de Nedjib Sidi Moussa qui rappelle que la période de l’exil actif « la plus ignorée par certains aspects […] révèle ce que fut Mohammed Harbi durant près d’un demi-siècle : un intellectuel postcolonial total et un socialiste internationaliste impénitent ».
Rencontres militantes
J’ai d’abord connu Mohammed Harbi dans un cadre militant. C’était déjà une « légende » pour les communistes autogestionnaires dont j’étais, et c’est à l’occasion d’une rencontre-débat organisée, sur invitations, par les CCA (Comités communistes pour l’autogestion) que je l’ai rencontré « en vrai », en 1978. Pas de souvenirs de ce qui se dit alors, ne me rappelant que des préoccupations logistiques de l’organisation de la réunion et de la sécurité de l’orateur, avec Maguy Guillien, Gilbert Marquis, Claude Kowal. Ensuite, quelques rencontres fortuites par hasard dans des cafés à Odéon ou vers la place du Châtelet, où il avait rendez-vous avec Michel Pablo, parfois aussi au téléphone pour l’interroger sur un nom ou un chiffre d’un article publié dans Commune, ou encore à l’Université Paris 8 avec ses collègues et surtout camarades du département de sciences politiques, Denis Berger, Jean-Marie Vincent, Michelle Riot-Sarcey. C’est surtout à partir du milieu des années 1990 que la relation se fit au fur et à mesure plus étroite, en 1995 pour le colloque « 50 ans de syndicalisme étudiant », en 2008 autour de la préparation du livre sur les 40 ans de 1968 par Syllepse et la BDIC (aujourd’hui La contemporaine) avec Irène Paillard, puis pour l’Association autogestion et les ouvrages édités chez Syllepse. Multiples occasions de retrouver et mieux connaître le fidèle ami Farouk Belkeddar, comme de faire connaissance avec la famille et d’autres figures de l’histoire algérienne. En toile de fond à partir de 2011, les dizaines de séances de travail et de tournage des Mémoires filmés avec Bernard Richard. (On se disait qu’on avait beaucoup de chance d’avoir un cours particulier de plusieurs dizaines d’heures).
L’ élégance
Mohammed Harbi, avait, comme on dit, fière allure. « Une vie debout », le titre de ses mémoires, cela lui correspondait très bien, y compris pour décrire sa posture physique. Rue Oberkampf, à Ménilmontant, dans nos quartiers, on le reconnaissait de loin à cette démarche, quasiment altière pourrais-je dire, sans, évidemment être hautaine. Mohammed, c’était l’élégance incarnée, et pas simplement vestimentaire même s’il était amateur de beaux vêtements, « un reste de mon éducation familiale » me disait-il. Oui, on pouvait aussi discuter de cela quand il remarquait que j’avais une nouvelle veste ou un couvre-chef récent Cette élégance était globale, signe de respect envers l’interlocuteur. On la retrouve dans la finesse, le raffinement de ses analyses et de ses écrits. Raffinement est le mot juste, puisqu’il ne lui suffisait pas de présenter les matériaux bruts récoltés dans les archives ou les entretiens, il lui fallait, tel un orfèvre, les ciseler avec les instruments et la rigueur de l’historien et du sociologue que Mohammed Harbi était également.
L’ édition était en conséquence une question importante, il ne manquait pas de me demander régulièrement le programme de publications de Syllepse, de faire passer le bonjour à Patrick Silberstein, et c’est ainsi qu’il s’engagea à nous « donner » un livre sur l’autogestion en Algérie, promesse honorée dans les temps.

Éditer, filmer
Le travail pour l’édition de L’ autogestion en Algérie comme autour des Mémoires filmés fut marqué par cette exigence qui était la sienne. Ce fut à la fois un plaisir, chaque séance de travail c’était d’abord un accueil chaleureux, il prenait les nouvelles des amis, des compagnes, des enfants, et ce n’était pas une politesse de mise mais bien un intérêt pour l’autre qu’il manifestait. Puis, verbalement, des faits, des hypothèses, des caractérisations, des anecdotes sur les personnes – il pouvait avoir des talents de conteur, avec beaucoup d’humour, comme lorsqu’il narra la tentative d’évasion de la prison avec Hocine Zahouane sur un registre plutôt comique. Avec son regard espiègle, son ouverture d’esprit, son côté chaleureux, il m’apparaissait plutôt comme jeune, un peu grand frère, pas comme un « vieux ».
Mais pour passer à la publication (à l’écrit ou en vidéo), graver en quelque sorte sur le marbre, s’avéraient nécessaires les vérifications, des dates, des noms, des lieux, peser les mots, arriver à la plus juste expression. Un travail présentable c’est le respect pour le public. Il n’était pas homme à courir les plateaux et les interviews au détriment du travail sérieux, refusant beaucoup de sollicitations. Il en acceptait bien sûr, pas pour « occuper le terrain » et paraître à tout prix, mais selon les enjeux historiques ou politiques, surtout quand elles émanaient de militants. À ce moment-là, malgré l’éloignement, la fatigue prévisible, il répondait présent, comme pour ce voyage à Cahors en janvier 2017 (5 heures et demi aller, autant le retour), pour un débat et projection organisés par Yves Quintal, avec l’accueil de Michel Auvray et de Geneviève Dreyfus.
Le tournage des mémoires filmés a duré dix ans, et quand – avec Bernard Richard – nous projetions les épisodes, Mohammed proposait des corrections, des amendements comme s’il s’agissait d’un livre, alors que l’insertion de compléments et le montage vidéo est autrement compliqué. Nous y sommes finalement arrivés.
Afin que nul n’oublie
« Afin que nul n’oublie », c’est l’intitulé que Mohammed Harbi avait choisi pour l’introduction de L’Autogestion en Algérie. Il ne s’agissait pas seulement de sortir l’expérience de l’autogestion de l’omission, c’était son désir de rendre leur place dans l’histoire à beaucoup d’individus qui en ont été effacés par l’histoire officielle, le pouvoir en place, ou par l’ignorance tout simplement. Mohammed avait une bonne, même une excellente mémoire des personnes, des évènements et il tenait à ce qu’elles ne soient pas omises. Dans ce livre, il s’agissait de celles et ceux qui ont joué un rôle dans l’autogestion. Il voulait ensuite, nouveau projet, que soit rappelée la contribution à la lutte d’indépendance des Juifs d’Algérie, comme celle des Français anticolonialistes, tant il craignait – à juste titre –que le chauvinisme entretenu par le pouvoir en Algérie n’efface pour de bon l’apport de l’internationalisme et des internationalistes.
Internationaliste militant comme internationaliste dans la recherche! Il était intéressé par les personnalités de Moshé Lewin et de Roland Lew, d’autant que leurs travaux, portant respectivement sur la paysannerie russe et chinoise, ouvraient des horizons à ses propres réflexions sur la paysannerie algérienne. Il les avait rencontrés chez lui, en présence de deux voisins de la rue Oberkampf, Denis Paillard et Daniel Bensaïd.
Mohammed Harbi a vu ceux de sa génération disparaître, il était affecté à chaque annonce de décès. En 2025, ce fut la perte de Hocine Zahouane, son compagnon de prison, d’évasion, de lutte, son complice, il y a quelques semaines à peine c’était du côté des « porteurs de valises » que nos vieux camarades partaient, Henri Benoits, et auparavant, Claude Kowal, celui qui avait eu l’idée des Mémoires filmés. Quand nous nous sommes vus pour la dernière fois en décembre, Mohammed m’a demandé encore ce qui était prévu pour rendre « l’hommage qu’il méritait » à Claude.
Transmettre avec générosité
Ce souci c’était celui de la transmission : transmettre l’expérience, l’histoire et les outils pour la faire, permettre aux nouvelles générations de s’en emparer et de les faire prospérer.
Enseignant dévoué à ses étudiants, il a continué après sa retraite et jusqu’à récemment à accueillir des étudiants, pour les aider, les éclairer pour leurs mémoires et thèses, notamment ceux d’Algérie où il sentait un renouveau d’intérêt. Aux côtés des plus anciens, une génération de chercheuses et chercheurs plus jeune s’est ainsi levée, comme Nedjib Sidi Moussa, Ali Guenoun, Sylvie Thénault, et d’autres encore. Il était fier d’avoir pu faire traduire, et voir édité en Algérie, Une vie debout, en langue tamaziɣt.
Il y avait en Mohammed Harbi, l’homme honnête, un homme inquiet, voire tourmenté. Il ne se contentait pas d’un retour critique sur le passé du mouvement national algérien et du FLN, c’était lui-même qu’il pouvait mettre en cause, s’en voulant d’une prise de position erronée, d’avoir eu des illusions à tel ou tel moment. Mohammed Harbi était à la fois engagé et lucide, débattant sur le fond, s’exprimant tout en étant loyal vis-à-vis du collectif. C’était une des formes de son élégance politique, étranger aux basses manœuvres, au cynisme et à l’hypocrisie.
Alors que les officiels d’Algérie rendent hommage à celui qui a été « un combattant anticolonialiste » jusqu’en 1962 et ensuite « un grand historien », comme s’il n’y avait pas eu les différentes options et désaccords dans la construction de l’Algérie indépendante, le coup d’État de Boumedienne, l’emprisonnement de Mohammed Harbi, il faut rappeler la vérité historique. C’est Mohammed Harbi qui écrit dans FLN : Mirage et réalité,
« Mais ceci doit-il empêcher de voir, en même temps, que dans ces victimes et ces rebelles de la colonisation sommeillent des maîtres dont le modèle n’est ni le fonctionnaire ni le colon, mais le caïd et le notable rural, symboles d’un pouvoir qui trouve ses racines dans la tradition nationale et qui favorise l’apparition d’un personnel politique dont les pratiques rappellent plus celles de la cour et du sérail que celles du militantisme. […] Convaincus qu’il fallait agir avec résolution pour se protéger contre les adversaires de la lutte armée, ils choisirent de manière délibérée la voie autoritaire. L’absolutisme a été érigé en principe contre les tendances à la conciliation. Rentré dans la place, il y demeurera en maître. ». Des leçons d’histoire qui débordent des frontières géographiques et chronologiques de l’Algérie, à valeur plus générale et encore d’actualité.
Incorruptible indépendance
Mohammed Harbi dans la clandestinité, a refusé d’être un permanent payé par l’organisation. Ses désaccords l’amenèrent à démissionner de la direction de la Fédération de France du FLN pour reprendre (sous surveillance, chose qu’il apprit plus tard) des études à Genève. Il accepta d’être fonctionnaire dans les cabinets de la Défense, des Affaires étrangères du GPRA, ambassadeur en Afrique, conseiller aux négociations d’Évian, auprès de Ben Bella pour l’autogestion, et ce dans un cadre précis, celui d’un service public au service des citoyens et des citoyennes, loin de profiter de prébendes comme l’ont fait nombre de dirigeants dès la fin de la guerre. En prison, il a refusé sa libération et les privilèges matériels offerts par l’appareil d’État algérien en échange d’un ralliement. En exil il refusa des offres de prestigieuses universités américaines qui auraient pu lui donner un bon salaire et de bonnes conditions de travail, ce qui l’aurait éloigné de l’Algérie et de ses activités à Paris. Il tenait à l’indépendance gage de libre expression. Il avait, dans Une vie debout, écrit :
«J’ai été militant, membre actif d’organisations et de partis. Je ne le suis plus. J’ai eu des responsabilités étatiques et je n’en ai plus. Je suis passé des couloirs du pouvoir aux cellules des prisons et aux froideurs de l’exil. Ce parcours et ma distance à son égard ont rendu plus exigeante une sensibilité historienne, dont je dois dire qu’elle a toujours été mienne, car je n’ai jamais perdu la conscience d’une historicité impliquant la longue durée, derrière le clapotis des urgences du présent et de la politique.»
En fin de compte, on ne peut séparer le militant de l’historien tant, dans les deux cas, la rigueur de l’analyse et des faits fut pour lui de mise. Ses combats ont nourri ses recherches. Ses recherches ont renforcé son engagement pour la démocratie. En effet, pour reprendre l’expression de l’ancien résistant et avocat anticolonialiste Paul Bouchet à propos de ce type d’acteurs de l’histoire, Mohammed Harbi n’était pas devenu un « ancien combattant », il était resté un vieux lutteur.
Pour aller plus loin
Notice dans le Maitron, dictionnaire Algérie, https://maitron.fr/harbi-mohammed/
Nedjib Sidi Moussa https://blogs.mediapart.fr/histoire-coloniale-et-postcoloniale/blog/040126/memoriam-mohammed-harbi-1933-2026
Mémoires filmés de Mohammed Harbi, 2021. Réal. Robi Morder et Bernard Richard (23 épisodes, 39 h au total) https://www.syllepse.net/syllepse_images/mohamed-harbi–me–moires-filme–s–sommaire.pdf
Mohammed Harbi, Aux origines du Front de libération nationale : le populisme révolutionnaire en Algérie, Paris, Christian Bourgois, 1975.
Mohammed Harbi, L’ Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, Paris, Arcantère, 1992.
Mohammed Harbi, Une vie debout (1945-1962), Paris, La Découverte, 2001.
Présentation de L’ Autogestion en Algérie : une autre révolution ? Syllepse, 2022. https://blogs.mediapart.fr/robi-morder/blog/190622/lautogestion-en-algerie-une-autre-revolution#_ftn7
FLN Mirage et réalité, [Jeune Afrique, 1980], réédition revue et augmentée, Paris Syllepse 2024.
Source : Mediapart – Billet de Blog – 12/01/2026 https://blogs.mediapart.fr/robi-morder/blog/120126/mohammed-harbi-l-elegance-d-une-vie-debout