À propos de : Thierry Hoquet, Histoire (dé)coloniale de la philosophie française. De la Renaissance à nos jours, Puf
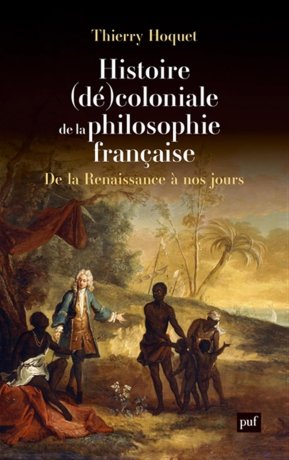
Les philosophes français n’ont pas toujours condamné l’entreprise coloniale : si au XVIIIe siècle, des voix s’élèvent pour condamner l’esclavage, elles sont nombreuses ensuite pour justifier les conquêtes, même si elles en dénoncent les excès.
Dans une « note sur le vocabulaire » qui sert d’introduction à cette histoire de la philosophie française, Thierry Hoquet distingue son projet de ceux des études postcoloniales et décoloniales, qui ont déconstruit les savoirs et les imaginaires européens en dénonçant leur caractère conquérant, oppressif ou raciste. L’auteur s’efforce « de voir au contraire comment la colonisation a provoqué des retours réflexifs et critiques » chez les philosophes, qui n’ont pas tous été sourds aux affaires du monde (p. 19). Les parenthèses du titre – Histoire (dé)coloniale – témoignent de cette démarche constructive, qui s’efforce de restituer la parole des voix dissidentes du passé. Thierry Hoquet s’attache aux penseurs qui ont critiqué le préjugé racial et la violence coloniale avant le temps des décolonisations, car, selon lui, « ce sont elles, plutôt que les trompettes de l’idéologie officielle, qui ont ouvert la voie à la philosophie » (p. 26).
L’ espace-temps de l’enquête varie en fonction de l’expansion de la France hors de la métropole : aux Amériques, dans la Caraïbe, en Afrique et dans le Pacifique. Chronologique, le récit s’organise en séquences découpées par de grandes dates de l’histoire politique de la France ou du monde : 1492 (la « découverte » du Nouveau Monde), 1598 (la promulgation de l’édit de Nantes et la fin des guerres de religion), 1715 (la mort de Louis XIV), 1789 (la Révolution française), 1815 (la Restauration), 1870 (le début de la Troisième République), 1945 (la fin de la Deuxième Guerre mondiale), et 1962 (l’indépendance de l’Algérie).
Enfin, pour définir l’objet de l’enquête, la philosophie, Thierry Hoquet situe ce savoir dans une tradition spécifique. Avec Barbara Cassin, il décrit le « contrat philosophique » comme une exigence pour « ceux et celles qui y participent, d’où qu’ils ou elles viennent, d’accepter de se traduire et de s’acclimater – autrement dit, d’entrer en dialogue avec une tradition issue de la Grèce antique » (p. 20).
Des Amériques à la Chine, à distance de l’islam
Historien des sciences naturelles et de l’anthropologie, c’est à travers le prisme de ces savoirs que Thierry Hoquet revisite les corpus de l’historiographie philosophique française. Avant l’anthropologie universitaire, les récits de voyages et de missions, réels, fictionnels ou fictionnalisés, ont constitué d’importants réservoirs de matériaux ethnologiques travaillés par les philosophes. L’histoire « (dé)coloniale » de la philosophie française narrée par Thierry Hoquet commence au Brésil, à la fin du XVIe siècle. Même s’ils le font dans des conditions et pour des motifs très différents de ceux d’autres populations, les Européens ne sont pas les seuls à voyager. Montaigne raconte avoir rencontré trois Tupinambas du Brésil à Rouen, en 1562. Il leur donne la parole dans ses Essais pour dénoncer les travers de la société française. La « découverte » du Nouveau Monde a fait perdre ses repères à la philosophie européenne, ouvrant un espace théorique pour la dénonciation de l’intransigeance religieuse et l’affirmation d’un relativisme culturel qu’a reformulé Pierre Bayle à la fin du siècle suivant. La science protestante, souvent négligée par les histoires générales de la philosophie française, voit son importance réévaluée par Thierry Hoquet.
À côté du Brésil, ce sont les « sagesses » de l’Inde et de la Chine qui fascinent. Disciple de Pierre Gassendi, François Bernier séjourne dix ans à la cour du Grand Moghol et il en revient avec des récits de voyages. Isaac La Peyrère, Pierre Bayle et Gottfried Wilhelm Leibniz (qui a écrit en français) confrontent les traditions philosophiques européennes à la pensée de Confucius, tandis que l’Amérique du Nord inspire au baron Lahontan son éloge de l’anarchie et de la vie « sauvage », débarrassée du fléau de la propriété privée. Cependant, une région du monde, définie par une religion plutôt que par des frontières politiques, a durablement repoussé les philosophes français : les terres d’islam. Des rivalités avec l’Empire ottoman au XVIe aux luttes décoloniales du XXe siècle, le musulman n’a cessé d’incarner l’autre irrationnel, la différence inexploitable, ou l’ennemi de la civilisation européenne. Voltaire et Montesquieu ne se sont pas intéressés aux traditions philosophiques arabes ; associé au despotisme politique, l’islam incarnait à leurs yeux une forme aiguë de fanatisme religieux. Parmi tous les philosophes dont il est question dans l’ouvrage, seul Auguste Comte paraît avoir appris du monde musulman.
Les ambiguïtés de l’altérité et de la nature
Le « travail d’intertraduction » à l’œuvre dans la pensée (dé)coloniale (p. 19) est porteur d’ambiguïtés constitutives dès le début de l’époque moderne. Appréhender les autres avec des catégories différentes de celles employées pour soi-même, et se penser en faisant un détour par l’autre, constituent deux opérations tributaires de sélections entre diverses formes d’altérité. À l’altérité américaine, au moyen de laquelle ethnologues et philosophes ont naturalisé l’homme et historicisé la nature, fut opposée une altérité plus proche et plus repoussante, celle du Moyen-Orient, en particulier du musulman. La première était naturelle, tout comme les Caraïbes ou les Hottentots chez Rousseau ; la seconde était politique et culturelle aussi. Dans les philosophies européennes, le point commun à ces deux pôles d’altérité consistait en leur détermination naturelle par les climats et les paysages. Tandis que, dès la fin du XVIIIe siècle, les Européens se sont définis par leur capacité à se libérer du déterminisme biologique, les autres peuples de la Terre y restaient strictement soumis à leurs yeux. Reconnaissant la présence d’un « fort eurocentrisme » dans l’anthropologie des philosophes des Lumières (p. 172), Thierry Hoquet invite à distinguer deux notions de nature : la nature comme matrice de valeurs et comme notion normative appliquée à l’Europe – par exemple dans l’idée de droit naturel –, et la nature comme ensemble de déterminations physiques à l’œuvre dans les autres sociétés, humaines et animales. Cette dichotomie était fondatrice de la conception du Code Noir, qui établissait que « les lois faites pour la France ne sauraient […] s’appliquer aux colonies » (p. 178).
Esclavage, colonialisme et décolonialisme
1685 fonctionne comme une année charnière dans le récit de Thierry Hoquet. La révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV et l’expulsion des Juifs des Antilles confirmèrent un catholicisme intransigeant, tandis que la promulgation du « Code Noir touchant la police des Îles et de l’Amérique » permettait de s’accommoder des monstruosités de l’esclavage pour favoriser le commerce. La France a alors basculé dans un colonialisme volontaire auquel se sont opposés les philosophes que Thierry Hoquet juge dignes de ce nom, ceux qui ont mené le combat abolitionniste : les physiocrates, qui rejetèrent l’esclavage au motif qu’il constituait un mauvais modèle économique, puis Voltaire dans Candide, Montesquieu, Diderot, Guillaume-Thomas Raynal, les philosophes de la Révolution et l’abbé Grégoire. À la Révolution, la reconnaissance de la citoyenneté des « personnes de couleur » (l’auteur préfère cette appellation à celle d’individus « racisés »), des femmes, et des membres du tiers état, a conféré à l’universalisme une nouvelle épaisseur sociale.
Puis, aux XIXe et XXe siècles, la question de la licéité morale de l’esclavage a fait place aux problématiques coloniales. Aux yeux de Thierry Hoquet, la cohorte des philosophes officiels de l’université française et du monde parisien ne mérite pas le détour de l’histoire (dé)coloniale : « Que trouvons-nous dans les œuvres de Cousin, Lachelier, Lagneau, Cournot, Hamelin, Boutroux, Ravaisson, Renouvier ? » demande-t-il de manière rhétorique (p. 209-210), avant de détourner le regard pour aller chercher la philosophie française du XIXe siècle en Suisse, dans le canton de Vaud, au sein du « groupe de Coppet » qui réunit, autour de Germaine de Staël, Benjamin Constant et Jean Sismondi. Constant n’est pas opposé à la colonisation qu’il envisage comme une œuvre civilisatrice. Le 28 juin 1830, dans Le Temps, il justifie la conquête d’Alger comme la prise d’un « repaire de pirates » (p. 217). Dans un climat marqué par de fortes tensions avec l’Empire ottoman, Sismondi en est un « partisan enthousiaste ». Selon lui, Alger, la « patrie de saint Augustin », devrait être libérée de la piraterie et de la tyrannie ottomane, plutôt que conquise (ibid.). En 1841, Alexis de Tocqueville se prononce lui aussi en faveur de l’occupation de l’Algérie, « tout en condamnant fermement les violences » (p. 225).
Tandis que les saint-simoniens, comme Charles Guillain, louent les vertus de la colonisation en Nouvelle-Calédonie (on pourrait ajouter à ce tableau le plaidoyer de Prosper Enfantin en faveur de la colonisation de l’Algérie), seul Auguste Comte mène, avec sa religion de l’Humanité, un projet dont Thierry Hoquet estime l’intention « absolument ‘décoloniale’ » (p. 228). Après le partage de l’Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885, le soutien des philosophes à l’entreprise coloniale s’accentue encore. Paul Leroy-Beaulieu la décrit comme la « force expansive d’un peuple » (p. 246). Jules Ferry défend le droit de « civiliser les races inférieures » (p. 246), et Léon Blum lui emboîte le pas sur cette pente. En 1887, le Code de l’indigénat, qui place les autochtones hors du droit français, est généralisé à toutes les colonies. Le philosophe français le plus international alors, Henri Bergson, ne s’émeut pas de la colonisation de l’Algérie et du Maroc. En 1915, dans un dialogue avec l’historien et sénateur américain Albert Jeremiah Beveridge, au cours duquel le philosophe français exprime vigoureusement son anti-germanisme, il justifie la colonisation du Maroc et de l’Algérie, car ces peuples, au contraire de la France agressée par l’Allemagne, n’étaient pas des nations, mais des « tribus en guerre » et des « bandes d’individus » (p. 251). À l’exception d’Auguste Comte, les reconstructions de Thierry Hoquet présentent une philosophie française du XIXe siècle largement favorable à la politique nationale de colonisation, même lorsqu’elle en dénonce les brutalités les plus extrêmes.
Autour de 1930, un véritable front intellectuel s’élève contre le colonialisme, mais c’est hors de la discipline philosophique que Thierry Hoquet doit aller en chercher les premiers protagonistes : les poètes surréalistes André Breton, Paul Éluard et René Char. Une femme philosophe, Simone Weil, exprime pourtant sa honte d’être française en traversant le zoo humain de l’Exposition coloniale de Paris en 1931. Après la Deuxième Guerre, le génocide des Juifs et les atrocités de la colonisation sont rapprochés dans la pensée décoloniale. Selon Aimé Césaire, Hitler a fait paraître le vrai visage de la « civilisation » européenne. Le marxisme et l’existentialisme se profilent alors comme les fers de lance du combat contre la domination coloniale dans le monde et l’oppression des minorités en France.
Langues et Lumières
Au XXe siècle, une attention nouvelle portée aux langues de la philosophie a nourri les combats décoloniaux et postcoloniaux. En faisant de la logique européenne un reflet de la structure de la langue grecque, Émile Benveniste a, selon Thierry Hoquet, provincialisé la philosophie, qui ne serait plus que l’expression d’une rationalité régionale. Avec Jacques Derrida et Édouard Glissant, un pluralisme linguistique qui dénonce le monolinguisme des philosophes a promu une nouvelle manière de penser entre les langues, que pratique aujourd’hui Souleymane Bachir Diagne. Glissant s’est livré à un examen critique de la langue française, la langue philosophique des « Lumières », et Derrida a lutté contre le principe colonisateur « en greffant les langues les unes sur les autres » (p. 308). Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, intitulé L’universel est-il européen ?, seul Emmanuel Levinas, souvent critiqué pour son eurocentrisme, paraît avoir complètement souscrit au « contrat philosophique » qui exige d’entrer en dialogue avec la tradition grecque antique. Thierry Hoquet souligne cependant que sa pensée a inspiré Enrique Dussel, tout comme celle de Michel Foucault, qui n’a jamais abordé de front la question coloniale, a été employée massivement dans les études postcoloniales et décoloniales.
En suivant le fil des controverses coloniales, l’histoire de la philosophie de Thierry Hoquet contribue à sa manière aux débats actuels sur la définition et la valeur des Lumières françaises. Trajectoire en dents de scie, elle définit les véritables Lumières comme combattantes, athées et critiques du pouvoir politique. Si « Descartes et son siècle font pâle figure, pris entre les vertiges sceptiques de la Renaissance et les vertueuses indignations des Lumières » (p. 89), « la philosophie française du XVIIIe siècle […] donne son sens au mot ‘Lumières’ » en combattant l’esclavage (p. 135). Enfin, après un XIXe siècle décevant et une première moitié de XXe siècle qui a vu la philosophie servir les ambitions de la nation, Frantz Fanon, ce « héros romantique de la décolonisation » (p. 288), est campé en « penseur des Lumières, un positiviste hostile par principe à toute religion » (p. 293).
Thierry Hoquet, Histoire (dé)coloniale de la philosophie française. De la Renaissance à nos jours, Paris, Puf, 2025, 334 p., 23 euros.
Source : La vie des idées – 02/10/2025 https://laviedesidees.fr/De-Montaigne-a-Fanon
